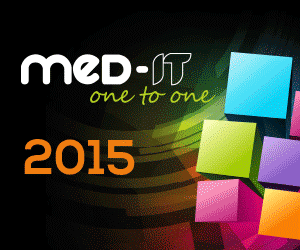L’habitat au Sahara comme dans l’ensemble du Maroc : même combat !
L’habitat contemporain au Sahara comme dans l’ensemble du Maroc inspire aux deux auteurs un triste constat : l’indigence de la technique constructive et de la conception architecturale. L’amnésie qui semble frapper le pays de son savoir-faire d’autrefois n’appelle pourtant pas un retour forcené au passé. La modernité devrait se nourrir d’un héritage formel et technique, de l’esprit du lieu, de la topographie comme du climat, pour répondre aux besoins des usagers d’aujourd’hui. Préconisations de bon sens et appel à une prise de conscience urgente!
Débattre sur le thème de l’habitat dans la région du Sahara annonce en fait un débat sur le problème de l’habitat au Maroc en général. En effet, l’environnement architectural saharien récent n’est pas très différent du reste du Maroc. On y retrouve l’éternel bourg « western » avec ses deux rangées d’immeubles « échassiers » pour moitié non peints et pour l’autre moitié « rose » Marrakech, indécise teinte censée rappeler la profondeur de la terre rouge du pisé. En « guest star » depuis quelques années, le « griffé », beige, rougeâtre, agrémenté ou non de paillettes, fait une belle percée. Depuis ces 10 dernières années, on voit donc fleurir ce même modèle de ciment, du nord au sud du Maroc. Parfois, une touche régionale s’y ajoute : petite tourette d’angle façon ksar, frise de faïence façon zelliges, fronton grec (!), etc., on trouve même des constructions mélangeant tous ces codes.
Voici donc le spectacle auquel nous avons désormais droit lorsque nous parcourons les routes marocaines. Grande déception pour celui qui les a connus 15 ans auparavant : petits villages construits avec les matériaux locaux, à flanc de colline, discrets, se fondant dans le paysage, blancs, peints à la chaux, tels une apparition délicate dans l’aplat bleu du ciel. Cette harmonie parfaite a fait place à une sorte de développement chaotique. Pour exemples, la vallée du Dadès a été englobée par une succession d’agglomérations s’étalant sur des kilomètres tout le long de la route. On a même du mal à apercevoir la palmeraie. Le développement des villes du sud comme Tan-Tan ou Dakhla est guidé par cette même voie, peu esthétique et surtout inadaptée au milieu.
Autre exemple marquant, l’oasis d’Amtoudi, qui voit petit à petit son ancien village de terre tomber en ruine au profit de constructions en parpaing installées de l’autre côté de l’oued, là où arrive « le goudron ». Des constructions modernes, de plusieurs teintes, agrémentées parfois de balustres napoléoniennes et de vitrages bleus.
Juste en face, règnent deux magnifiques igoudar.
Que s’est-il passé pendant toutes ces années?
Comment a-t-on pu, à l’époque, construire ces greniers fortifiés, d’une beauté et d’une poésie incroyables et aujourd’hui développé des architectures pauvres, dépourvues de sens? Il semble qu’un des facteurs principaux de ce développement soit l’arrivée en force de l’automobile et des routes qui ont permis l’avènement du ciment et du parpaing dans des villages reculés. Ce sont les axes de circulation qui guident désormais l’urbanisme de nos villes au détriment du piéton. On agrandit sans arrêt les rues, les avenues, les entrées de ville. On a l’impression que les villes du pays sont en concurrence pour la plus grande « voie royale », avec un maximum de réverbères à des prix très onéreux. C’est cette même voie qui reste bordée de constructions anarchiques aux couleurs multiples.
Aujourd’hui, les villages et les villes semblent se construire sans vision urbanistique : on pose un « cube de ciment » là et on refait pareil un peu plus loin. Plus d’intégration au site, aucune question par rapport à l’orientation du bâtiment. Par contre, il semble que l’habitant moyen ait grandi (et/ou grossi!), car il nous faut maintenant de très grandes chambres, de grandes cuisines, des salons pour recevoir tous les jours. En somme, il faut de la surface. Étonnant pour des familles moins nombreuses qu’il y a 60 ans. Ces surplus de surface impliquent des problèmes de chauffage, car oui on gèle dans les bâtiments du Maroc.
Mais, ce n’est pas si grave puisque beaucoup n’hésitent pas à installer la climatisation, devenue très accessible financièrement. On touche là un autre facteur qui est le système dans lequel nous vivons : il faut consommer, construire, faire du profit; tout devient commerce. On s’éloigne de la qualité au profit de la quantité, et ajouté à cela le manque de formation et d’éducation, voici ce qui nous donne le nouveau paysage architectural marocain.
Il n’est pas rare de voir un maçon ou une entreprise vous proposer l’encadrement de votre porte d’entrée en faïence ou un peu de vert pistache pour vos fenêtres ou du griffé contre l’humidité. Le menuisier, lui, vous orientera vers un vitrage bleu réfléchissant. C’est moderne quoi! Celui qui n’y connaît rien leur fera confiance et acceptera toutes ces belles propositions… On connaît le résultat !
Quel logement adapter?
Il n’y a, hélas, pas de débat possible sur de telles options. Il n’y a qu’un constat. Le Maroc, grand pays de construction en terre, des montagnes de l’Atlas au Sahara, perd petit à petit son patrimoine et aucun essai contemporain de construction en matériaux locaux n’est proposé.
Lorsque nous avons décidé de venir nous installer au Maroc à la fin de l’année 1999, c’est l’envie de construire en terre qui a guidé notre choix, car ce pays possède une grande qualité architecturale dans ce domaine.
15 ans plus tard, malgré nos diverses propositions, que ce soit dans les concours ou dans nos recherches personnelles, nous n’avons construit qu’une seule villa en terre cette dernière année, alors que le paysage architectural inadapté s’accroît tous les jours dans un chaos le plus total.
Le sud du Maroc suit la destinée de Temara ou d’Aïn Aouda : une frénétique effervescence constructive!
Réfléchir à la question d’un logement adapté est pour nous la base de la réflexion que doit mener un architecte. Où construire? Avec quels matériaux? Pour qui? Je ne fais pas la même chose à Tanger qu’au Sahara. Or, au Maroc, on se retrouve avec les mêmes modes de construction du nord au sud, ce qui est désespérant pour un pays qui possédait des modes de construction traditionnelles très variées selon ses régions (pisé, briques de terre, pierre, textile, etc.).
L’habitat traditionnel marocain faisait d’abord face à des contraintes climatiques et c’est ce qui allait orienter la forme du bâtiment.
Au Sahara, il faut se protéger du vent et du soleil, mais également du froid pendant la nuit : trois contraintes qui demandent un réel travail de recherche.
Les architectes doivent s’inspirer de l’environnement où ils construisent. L’habitat traditionnel était souvent très bien pensé par rapport aux besoins de l’époque. Il faut le réadapter à notre façon de vivre actuelle en y apportant le confort auquel nous sommes habitués. Il devient urgent d’arrêter de copier un modèle occidental aux techniques non maitrisées et d’œuvrer pour une architecture contemporaine marocaine en symbiose avec son environnement pour retrouver le génie du lieu.
Myriam Soussan et Laurent Moulin
Architectes