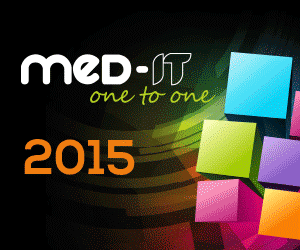L’espace urbain à Oujda et le lien social
La Région de l’Oriental du Maroc vit depuis plus d’une décennie un véritable regain de vitalité. Longtemps demeurée endormie, cette région connaît, en effet, un processus de transformation sous l’influence de grands projets urbains lancés sous l’Initiative Royale de Développement.
Est-ce pour autant un droit de cité pour tous ? Qui s’approprie l’espace public et comment ?
Houria Rabhi est Oujdia et tente de répondre à ce questions.
L’envergure impressionnante des multiples projets touristiques, technologiques, des infrastructures de base fait de la région de l’Oriental un pari gagnant pour le futur. Les processus d’urbanisation sont nettement décelables dans les interactions entre changement social et changement spatial. La confrontation du présent au passé nous permet de percevoir les changements qui se sont produits dans la région de l’Oriental. Ils ne peuvent avoir de sens s’ils ne sont pas projetés sur un arrière-plan. Les grandes modifications de structures ont eu un impact évident sur les mentalités et ont démontré qu’aucune culture humaine n’est statique et que même le plus grand des conservatismes ne peut être épargné par les changements issus de la modernisation.
En tous les cas, les concepts d’enclavement et d’inutilité ou de dépendance frontalière dont le Maroc Oriental était entaché sont dépassés parce qu’ils sont, aujourd’hui, compensés par des réseaux de communication aussi bien autoroutiers, ferroviaires qu’aériens. La valorisation de ses atouts indéniables est manifeste sous des angles à la fois géographique, historique et humain, économique et partenarial, qui témoignent aujourd’hui d’une ouverture interculturelle et d’une mobilité socio-économique déjà opérationnelles et prometteuses. Nous pouvons dire que le destin incontournable de la région frontalière d’Oujda est un carrefour d’influences étrangères diverses que l’historien Fernand BRAUDEL résumerait en cette phrase : « Les civilisations se font sur les frontières »

Place Bab Sidi Abdelwahab Oujda interpelle le retour des animations traditionnelles comme les diseurs de contes
Quelques regrets subsistent cependant dans la mémoire de ceux qui ont connu l’ancienne Oujda quant aux arbres et la double voie qui caractérisaient le boulevard Mohammed V dans les années 60 ; ou encore, en 1992, la démolition du marché couvert municipal remplacé par un immeuble à six niveaux et des locaux commerciaux dont moins de 20% sont aujourd’hui ouverts et exploités.
La préservation du patrimoine culturel et naturel de la région de l’Oriental constitue également une dimension essentielle autour de laquelle s’organisent plusieurs partenaires et associations. La fondation Moulay Slimane située au cœur de la Médina d’Oujda, est un espace ouvert au public soucieux de la conservation de l’identité et de l’histoire de la ville. Les manifestations culturelles et artistiques qui s’y déroulent traduisent la volonté ferme de conserver la mémoire des différentes générations par l’exposition des produits d’artisanat, des costumes et des recettes culinaires traditionnels de la région. Les organisateurs sont conscients du fait que la mise en valeur du patrimoine contribuera sûrement au développement de la Région et à celui du secteur touristique en particulier.
Si nous observons les dynamiques à l’intérieur des villes de l’Oriental, nous pouvons affirmer que les impacts et les enjeux de l’urbanisation sur les mentalités de la population ne sont pas moindres puisque nous assistons à une émergence plurielle des espaces publics et la mobilité sociale comme principale caractéristique des comportements. Le réaménagement urbain de certains espaces publics, comme les parcs, jardins ou musée, invitent et incitent ses habitants à développer un regard nouveau sur ces espaces qui fonctionnent à leurs yeux comme lieu de relations sociales et de médiation sociale. Néanmoins l’observation montre que certains espaces publics sont souvent squattés par une certaine population comme résidence principale, lieu d’intimité, de jeux, de préparation d’examens et autres…
La modernisation des espaces a engendré de nouveaux modèles de conduites sociales qui touchent plus particulièrement la mobilité des femmes et des jeunes et la façon dont ils occupent ces espaces. L’expression la plus éloquente du changement social dans le Maroc oriental est l’émergence accrue des femmes dans les espaces publics sous l’apparence de nouvelles identités sexuelles et de plusieurs modèles de beauté et de paraître. Les modes de vie des habitants de la région de l’Oriental ne correspondent plus à celui que prescrivaient les traditions locales. Naturellement, les lieux fréquentés changent selon la catégorie sociale, l’âge, le statut professionnel et conjugal de la femme, son niveau culturel et économique.
Les questions de fond restent de savoir comment la population qui investit ces espaces publics et privés se les représente ? De quelle façon tente-t-elle de se les approprier ?
Une partie de la population souffre de l’injustice spatiale tout simplement par l’exclusion des espaces issus de la modernité. Une réflexion sur les recours et les stratégies de contournement pour avoir droit au patrimoine de la vie urbaine serait judicieuse.
Par ailleurs, la modernisation des souks de quartiers implique en même temps la sauvegarde de plusieurs commerces menacés de disparitions et la valorisation de certains métiers comme les vendeurs de karane (flan de pois chiches qui constitue une tradition culinaire de la région.)
De même, afin de donner à l’intégration sociale une chance de l’emporter sur l’explosion de l’urbanisation, la société civile de la région de l’Oriental a besoin d’être incitée à devenir un sujet actif qui génère de la créativité au sein de son patrimoine urbain et traditionnel pour maîtriser les défis inhérents au présent et au futur.
Des questionnements qui relèvent du comportement civique de différentes populations et de l’importance d’intégrer le facteur humain dans les stratégies de l’aménagement des espaces publics.
La modernisation des espaces a non seulement favorisé la proximité entre les populations internes, mais aussi facilité les interactions et leur développement en termes d’échanges et de partage de connaissances. De même, l’impact du changement social sur les rapports entre les sexes n’est pas moindre à ce jour, puisqu’il porte directement sur la question essentielle des mentalités en lien direct avec la métamorphose des espaces publics.
Il convient d’accompagner l’ampleur de toutes ces modifications des espaces publics par une réflexion et un questionnement sur les valeurs que préconise la conception environnementale. Le facteur humain et l’approche écologique dans l’architecture urbaine ont toute leur importance. De même, quel sens peut avoir un bâti pour le vécu de ses habitants s’il est dépouillé de toute sa mémoire et de ses équilibres ? Comment ses habitants peuvent-ils se concilier ces nouveaux espaces si l’esprit du lieu fait défaut ?
Bab Sidi Abdelouhab est une place qui interpelle le retour des animations traditionnelles comme les diseurs de contes et la mise en valeur de toutes les imaginations créatrices de l’art sous toutes ses formes.
Le constat des mutations socio-urbaines de la population de l’Oriental nous fait penser que nous avons à progresser dans les espaces fondamentaux de la vie humaine qui touchent la vie publique. Plusieurs espaces restent encore à conquérir par les femmes, les jeunes et les enfants. La dichotomie ou la dissociation qui règne encore en filigrane entre les valeurs traditionnelles et celles issues de la modernité déteint sur les modes de vie et la relation aux espaces publics.
L’importance d’instaurer une éducation citoyenne et transversale dans les familles, les institutions scolaires et universitaires, à tous les niveaux de la vie socio-professionnelle s’avère capitale pour une meilleure implication dans les espaces.
Confronté au défi transversal du développement, l’Oriental ne peut rayonner par le seul recours à l’urbanisation, la multiplicité des édifices etc. Il rayonnera davantage par l’émergence d’une détermination créatrice de valeurs par des hommes et des femmes conscients du lien essentiel qui existe entre soi et le lieu où l’on vit.
Houria Rabeh