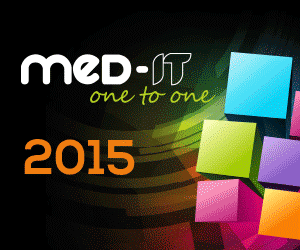L’espace libérateur
Nedjma Hadj vit et travaille à Bruxelles. Elle est auteure, réalisatrice de films documentaires et programmatrice aux Halles de Schaerbeek. Le 27 mai dernier, elle donnait une conférence à l’Atelier de la Source du Lion sur la danse dans le monde arabe. L’actualité donne un écho particulièrement percutant à ses propos puisque c’est un chorégraphe qui a lancé un nouveau mode de protestation en Turquie. Des centaines de personnes stationnent sur les places des villes, debout et silencieux, pendant des heures…
Architecture du Maroc : Quelle est la contribution de la danse dans le monde arabe à la chorégraphie contemporaine aujourd’hui ?
Nedjma Hadj
Je constate depuis dix ans la contribution indéniable des pays du Maghreb et du Moyen-Orient aux mouvements de la danse contemporaine. Cette évolution est d’autant plus intéressante que cette discipline s’impose moins facilement, moins naturellement dans ces pays que le théâtre ou tout autre art de la scène. La reconnaissance institutionnelle manque en effet et il n’y a pas de scène permanente. Toutefois, des initiatives ont permis à la danse contemporaine d’exister et de rencontrer un public très jeune. Peu de moyens, beaucoup d’ambition peuvent résumer l’élan de ces artistes, danseurs et chorégraphes de la région. Ils sont en lien avec le monde arabe, avec l’Afrique mais aussi avec l’Europe, et s’expriment tantôt à travers des ateliers qu’ils suivent ou donnent, soit par des créations. Chacun développe un vocabulaire qui lui est propre, mais tous puisent au terreau de la danse contemporaine européenne et trouvent dans leurs propres racines et dans leur héritage ancestral matière à élaborer des langages originaux et créatifs. Ils s’inscrivent tous dans leur époque, dans l’actualité, dans le contexte de leur région.
AM : Vous êtes architecte et évoluez dans le milieu de la danse que l’on définit comme le rapport du corps à l’espace. Comment cet espace évolue-t-il ?
N.H.
Les corps s’expriment dans les rues comme sur les scènes. Dans tous les cas, le plateau ose devenir tribune. Les nouveaux regards portés sur soi et sur autrui font des artistes de cette région des artistes de la cité. Un dialogue complexe s’établit entre les défis, les exigences actuelles et les transformations profondes qui traversent le monde arabe dans toute sa diversité. Il y a une sorte d’urgence dans ces mouvements créatifs, forts et intenses, qui traduisent des moments vécus en collectivité, des moments protestataires issus de la volonté d’investir l’espace. C’est effectivement une notion qui vient de la rue. Et la rue c’est une matière très riche qui signifie aussi bien le regroupement, le fait d’être ensemble que la solitude ou l’anonymat. Corps scéniques ou urbains, la rue les nourrit.
AM : La dimension politique est-elle essentielle ?
N.H.
La relation est réelle avec le contexte et la société dans lesquelles ces mouvements s’inscrivent, mais ce ne sont pas pour autant des documentaires. Sur scène, la transgression se fait poésie ou rêve. Comme le disait Francis Alÿs « Parfois faire quelque chose de poétique peut devenir politique, faire quelque chose de politique peut devenir poétique ». La danse dispose d’un espace libérateur, ancré dans son contexte et en rapport avec son temps, mais capable de magnifier et de dépasser la réalité.
AM : Vous souligniez à l’instant la multiplicité des identités du monde arabe. Y a-t-il un fil rouge, une caractéristique qui les singulariserait par rapport aux autres régions du monde ?
N.H.
Je crois que leur point commun tient au fait qu’ils sont toujours inattendus. C’est à chaque fois la surprise lorsque troupes et chorégraphes s’expriment sur scène, dans la rue ou sur les toits des abattoirs de Casablanca (œuvre de Hassan Darsi, Taoufiq Izeddiou et Seif). Je crois aussi que l’urgence, comme je l’évoquais plus haut, est la nouvelle composante dramaturgique, quel que soit l’objet de partage – la revendication, la violence, la peur, la colère ou la poésie. C’est le moteur, le carburant qui pousse à aller chercher le public et à dialoguer avec lui.
Propos recueillis par Florence Michel-Guilluy