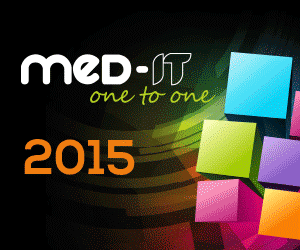L’accès des jeunes à la profession d’architecte
Le parcours professionnel de l’architecte qui démarre est semé d’embûches. D’une part à cause de la difficulté d’accès aux projets, d’autre part à cause de l’évolution du métier. Brahim Abansir fait le point et tire des conclusions sur la pratique professionnelle au Maroc. Mais avant de proposer un mode d’exercice, il propose un bench-marking concluant avec d’autres pays. Enrichissant !
Une histoire brève :
L’architecte exprime par des esquisses ou des croquis la configuration d’un ouvrage ou d’un espace. Il dégage les possibilités techniques les plus adaptées à la construction et au site en tenant compte des contraintes imposées par le client, le plan d’urbanisme ou l’environnement. Il assure la direction générale de l’exécution des travaux. Il travaille aussi bien à des projets de construction, de rénovation ou de transformation.
L’architecte est un spécialiste de l’art de bâtir, un professionnel qui doit combiner l’imagination, la connaissance, le savoir-faire et l’expérience.
Il doit être capable de maîtriser toutes les phases de conception d’une réalisation, d’en diriger et d’en contrôler les différentes étapes d’exécution.
Prologue :
Il est très difficile pour un jeune architecte de se lancer dans l’exercice de sa profession à titre libéral.
Les obstacles sont de divers ordres :
– la difficulté de se constituer une clientèle, alors que l’on a encore peu de références, et que la petite structure que l’on a constituée ne suffit pas à inspirer la confiance nécessaire ;
– un certain manque de connaissances pratiques sur les pièges du métier ;
– la nécessité de faire face à un budget de fonctionnement qui avoisine, hors salaires, les 120.000 dirhams par an.
Dans ces conditions, il est téméraire de prétendre se lancer, d’emblée, dans l’exercice libéral de la profession d’architecte.
La commande publique apparaît encore aux architectes comme un moyen privilégié d’obtenir du travail, des contrats et des références, en répondant aux appels d’offres lancés par les maîtres d’ouvrage publics.
Pour autant, l’accès à la commande publique paraît malaisé aux jeunes architectes : la présentation d’un projet, en réponse à un appel d’offres, suppose de se familiariser avec un langage administratif et de se plier aux règles qui encadrent la constitution d’un dossier de candidature ; en outre, leur absence de références et d’expérience sont autant d’handicaps qui leur laissent peu de chances d’être retenus.
La plupart des jeunes architectes conviennent de la nécessité de commencer par travailler en qualité de salarié, ou en association avec des partenaires déjà bien au fait du maillage local, auprès desquels ils pourront acquérir de l’expérience et nouer des contacts.
Il faut ajouter que la profession d’architecte a connu plusieurs évolutions ces dernières années.
Au-delà du développement technologique des outils (par exemple, le dessin assisté par ordinateur), se sont ajoutés les enjeux économiques et la prise en compte de la durabilité et de la qualité environnementale du bâti.
Le monde du travail a tellement changé et a considérablement évolué ces dernières années.
Les architectes, surtout les jeunes architectes, sont appelés à définir ou à redéfinir leur rôle, leurs positions et leurs missions dans un contexte marqué par de profondes mutations.
Diagnostic :
La condition sociale et institutionnelle dans laquelle les architectes exercent leurs activités est marquée par la prégnance de modèles professionnels hérités.
Il est vrai que chaque profession délimite le champ et les modalités d’exercice de son activité en se fondant sur un certain nombre d’aptitudes prédéfinies, qui se transmettent à travers les systèmes de formation et les processus d’apprentissage auprès des pairs, et dans le cadre d’expériences professionnelles diverses.
Aussi, chaque profession inculque à ses membres un savoir et un savoir-faire particulier qui constituent une culture professionnelle partagée, sur laquelle ils construisent leur légitimité d’action et fondent leur identité.
En général, les professions développent des dispositions intériorisées par leurs membres, elles travaillent à faire reconnaître ces conventions par les acteurs de l’environnement dans lequel elles évoluent et avec lesquels elles coopèrent.
La délimitation du champ d’activité et la définition des pratiques légitimes font l’objet d’un travail sans cesse renouvelé, d’autant plus intense que l’environnement et les problèmes à résoudre évoluent.
Ceci est vrai pour toutes les professions qui luttent en permanence pour assurer leur reconnaissance et asseoir leur légitimité. Mais c’est sans doute encore plus prégnant pour les professions qui ont une longue histoire derrière elles et qui se sont progressivement codifiées à travers différents processus historiques, comme c’est le cas des architectes.
Il faut noter aussi qu’une profession très structurée et régulée par ses propres membres est peu encline à innover. Le fait que ses membres soient en permanence en concurrence pourrait limiter le développement de formes de coopérations internes d’une part, et d’association avec d’autres acteurs professionnels sur un mode égalitaire d’autre part.
Cette profession est en outre menacée, à la fois par les maitres d’ouvrage qui tentent de limiter l’espace de liberté des concepteurs, mais surtout par les entreprises et les ingénieurs qui leur imposent des contraintes techniques et s’efforcent mêmes de se passer de leurs services ou encore de les assujettir.
Les nouveaux enjeux énergétiques imposent désormais à l’architecte d’accorder une attention toute particulière aux dimensions climatiques de ses réalisations. C’est en effet dès la conception et la réalisation d’un bâtiment que se déterminent ses besoins énergétiques et donc sa performance. Les projets de construction doivent tenir compte de l’isolation thermique, de la ventilation et de l’étanchéité à l’air, des apports solaires, du rendement des systèmes de chauffage et de l’utilisation des sources d’énergies renouvelables.
Ces évolutions s’accompagnent d’une complexification du cadre légal et administratif. On le voit, une grande partie des changements se situe au moment de la conception d’un bâtiment. Malheureusement, les architectes ont été assez peu formés dans ce domaine, si bien qu’une partie seulement d’entre eux sont compétents en la matière et tiennent vraiment à se soucier de la performance énergétique de l’enveloppe.
Peu d’architectes ont des compétences en matière d’aménagement paysager, car leur culture est principalement fondée sur la création d’espaces fonctionnels.
La pression actuelle en faveur du développement de la nature dans la ville les conduit à s’associer à des paysagistes et, de plus en plus, à des spécialistes du développement durable.
Les architectes n’ont pas tous non plus une forte maîtrise de la gestion économique des projets, ni des coûts de maintenance générés par leurs propositions ou encore de la gestion des risques économiques, ce qui les fragilise dans une période où les investisseurs sont soucieux de réduire ce type de coûts.
La complication des projets entraîne la sollicitation d’une grande diversité de spécialistes en fonction de la nature des problèmes à traiter. Ce phénomène, auquel s’ajoutent les contraintes de la rentabilité économique des équipes, conduit à une fragmentation des missions qui remet en cause, dans de nombreux cas, le rôle et la responsabilité centrale des architectes comme organisateurs de la conception des projets.

Armin Linke, Ettore Sottsass, Lego House in Studio, Milan, Italy 1999. Structure renvoyant à l’enfance.
On est donc dans une situation où les contradictions tendent à se développer entre une profession, dont le champ d’activité était très délimité et structuré et qui jouait un rôle central, et la diversification et la fragmentation des compétences requises pour réaliser des projets.
La préservation de l’identité professionnelle joue un rôle majeur dans cette profession et constitue un enjeu fondamental des évolutions en cours. Cette identité repose notamment sur le fait que les architectes se veulent les auteurs des projets, souvent indépendamment des multiples professions qui concourent à leur conception et leur réalisation.
Contexte…
Tout le monde s’accorde à penser que l’on assiste à une complication des opérations et à l’accroissement des incertitudes qui pèsent sur leur réalisation. Il était relativement aisé de réaliser des opérations de construction de grande envergure, tandis que la restructuration des tissus urbains existants met en jeu les intérêts de multiples acteurs : les propriétaires des terrains, les propriétaires des immeubles ou des équipements, les communes, les usagers des sites concernés, les aménageurs et les promoteurs, les sociétés gérant les réseaux (eau, électricité, télécommunications, pompiers…). On le voit bien dans les projets de restructuration urbaine, où il ne suffit pas de concevoir des plans d’urbanisme et où il est nécessaire d’opérer un travail de médiation extrêmement complexe entre les différents acteurs impliqués et d’ajuster le projet à plusieurs reprises pour intégrer leurs exigences respectives.
Les évolutions économiques sous-tendent les nouvelles formes d’activités professionnelles, mais elles ne les déterminent pas pour autant. Elles constituent des contraintes que les acteurs doivent prendre en compte et auxquelles ils doivent s’adapter. Le renforcement des contraintes économiques s’accompagne de processus de rationalisation qui touchent désormais les modes d’organisation de la conception et de la conduite des opérations, après avoir été liés au développement technique.
C’est cette rationalisation à la fois technique, économique et organisationnelle qui sous-tend aussi bien le développement des composants de construction que les procédures de certification des maîtres d’œuvre.
Cette rationalisation est également facilitée par le développement des techniques de communication, qui permettent d’organiser les échanges d’information entre les acteurs, et donc de fiabiliser ces échanges et de stocker les informations transmises. Mais ces techniques de communication contribuent aussi à organiser leurs relations. Elles affectent également le contenu du travail de conception et sont aussi utilisées pour valoriser les projets à travers le recours aux simulations virtuelles. Ce sont donc aussi des instruments commerciaux. Cet usage est également favorisé par les évolutions économiques, qui amènent à considérer les activités de conception comme des prestations de service faisant l’objet de démarches commerciales.
Eloge d’ailleurs :
En Grande-Bretagne, il existe une véritable culture du partnership. Cette culture concerne notamment le développement du partenariat public-privé aboutissant à ce que les institutions publiques délèguent entièrement ou en grande partie au secteur privé la maîtrise d’ouvrage, la gestion financière et la réalisation des opérations. On assiste ainsi à un assouplissement des contraintes juridiques, favorisant ainsi des coopérations plus souples entre les promoteurs, les maîtres d’œuvre et les entreprises.
Une autre caractéristique du monde anglo-saxon est la forte culture de l’organisation. Ils s’interrogent fréquemment sur la pertinence des modes d’organisation et expérimentent en permanence en ce domaine.
En France, le rôle des collectivités locales est plus important que celui de l’Etat, résultat du mouvement de décentralisation engagé il y a une trentaine d’années. Elle se traduit par une croissance de la commande publique locale, et de l’activité des professionnels, et par une fragmentation et une différenciation des projets. Une évolution qui accroît les exigences d’adaptation des opérations aux spécificités des contextes locaux et appelle de nouvelles compétences.
En Italie, il existe une tradition culturelle d’attention à la qualité des moindres détails, et le développement du design industriel influence la conception artisanale.
En Autriche, il existe une coopération étroite des concepteurs avec les vidéastes qui s’inscrit dans la tradition viennoise de coopération des architectes avec les peintres et les sculpteurs qui a été notamment développée par le mouvement de la Sécession et le Jugendstil au début du vingtième siècle.
En Finlande, la culture politique de démocratie participative constitue un contexte extrêmement favorable à l’expérimentation de différentes formes de participation des habitants à la conception des projets.
Des pistes de réflexion :
On s’accorde sur le fait que le contexte culturel influence profondément le développement de nouvelles formes d’activités, mais également les modes d’approche et de résolution des problèmes.
L’ «éloge d’ailleurs», nous renvoie à quelques domaines d’exploration et d’action distincts :
En relation avec la conception des objets à réaliser, où comment gérer la tension entre la valeur sociale et la valeur économique :
Ceci concerne aussi bien le design de composants que la coopération des architectes avec des scénographes ou des graphistes.
Ces champs d’exploration renvoient à de nouvelles formes de coopération et de collaboration avec les milieux artistiques ou avec les milieux industriels.
Ils procèdent de l’intégration de nouvelles compétences dans le processus de conception aussi bien industriel qu’artistique, influençant ainsi le processus de production de nouveaux langages, nouveaux produits et nouvelles formes.
En relation avec l’organisation dans les processus de conception ou œuvrer pour être partenaires plutôt qu’adversaires :
Le développement de systèmes comme le Design and Build comme c’est le cas en Grande-Bretagne, la constitution de
réseaux d’architectes assurant la promotion d’un label certifié. Ceci permettra le développement de nouvelles formes de coopération et d’organisation de réseaux qui porteront à modifier les processus de conception.
Il s’agit de changements organisationnels profonds, puisqu’ils aboutissent à une recomposition des configurations de coopération professionnelle entre les fonctions de maîtrise d’œuvre et l’adoption de procédures communes, fondées sur une charte de qualité.
En relation avec les processus politiques et sociaux de décision ou mettre la pression en faveur de réformes :
Il s’agit des projets qui nécessitent un travail de médiation entre une multitude de partenaires (Etat, commune, société d’aménagement et promoteurs).
Selon les contextes, la fonction de maîtrise d’œuvre architecturale peut être exercée différemment :
– soit elle englobe d’autres compétences et d’autres fonctions d’organisation et de médiation ;
– soit elle glisse vers des fonctions de conseil et de médiation, mais en s’appuyant sur sa légitimité et ses compétences de maître d’œuvre ;
– il arrive qu’un architecte soit nommé chef de projet d’un programme complexe et n’exerce pas réellement en tant que maître d’œuvre, mais utilise les compétences et la légitimité liées à sa formation d’architecte.
Ces fonctions d’organisation et de médiation assurées par les architectes s’inscrivent dans un rôle d’assistance à la maitrise d’ouvrage publique et concernent des projets urbains, ou des projets de construction qui ont des incidences sur le fonctionnement urbain.
Des projets qui représentent des enjeux politiques considérables et conditionnent le devenir de quartiers entiers ou une grande partie des villes.
Qui, Quoi, Comment… ?
Les chapitres esquissés auparavant tendent à considérer que les changements professionnels résultent des capacités des acteurs, en l’occurrence les jeunes architectes, à saisir les opportunités que leur offrent les évolutions structurelles et à gérer les diverses situations particulières dans lesquelles ils opèrent, ainsi que les contraintes auxquelles ils sont confrontés.
Les changements professionnels résulteraient du travail de médiation et d’ajustement que les acteurs seraient en mesure de réaliser entre ces deux niveaux de réalité.
Des évolutions et des situations qui tendent à destabiliser les acteurs s’inscrivant dans des schèmes traditionnels sont, au contraire, saisies comme des opportunités par ceux qui se positionnent autrement, qui n’ont pas complètement intériorisé ces schèmes ou qui n’y trouvent pas leur place et qui, en outre, disposent de capacités à exploiter les espaces ouverts par des situations inédites.
Néanmoins, il est important de se questionner sur l’incidence de ces changements professionnels sur le contenu même des projets.
Tout porte à penser que les nouveaux modes d’exercice professionnel explorés par les jeunes architectes se traduisent par une meilleure prise en compte des attentes des commanditaires ou des usagers. Quoique le fait de s’inscrire dans de nouveaux processus de conception impliquant une coopération étroite avec les commanditaires, les autres acteurs professionnels ou les usagers n’entraîne pas mécaniquement un changement significatif de la conception des projets.
Les jeunes architectes peuvent tout à fait exploiter leurs capacités de coopération avec les autres acteurs pour légitimer et reproduire les modèles de conception architecturale ou urbaine dont ils sont porteurs, modèles qui ne diffèrent pas nécessairement sur le fond de ceux élaborés par les concepteurs s’inscrivant dans les schèmes d’activité traditionnels.
Brahim Abansir