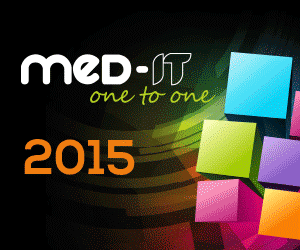Le ksar d’Assa : de la cité sainte à la ville nouvelle
Fondée au XIIème siècle sur un piton rocheux qui domine une source pérenne exploitée par une belle oasis, Assa, la cité de terre et de pierre, port saharien où s’approvisionnaient jadis les caravanes, s’étend sur plusieurs hectares. En 2006, l’Agence de développement du sud lance un programme de restauration autour du vieux ksar, témoin culturel et historique des liens unissant le Maroc au Sahel, avec l’ambition de doter la ville d’un ensemble patrimonial restauré, capable à la fois de former des maîtres artisans qualifiés et d’attirer les flux touristiques.
Le travail prendra fin en 2011. Une méthode participative et une formation touchant toute la société civile ont été mises au point durant cette période, dans l’objectif de restituer le ksar et lui redonner vie. Il s’agissait de concevoir une restauration qui ne soit pas une coquille vide, mais le lieu d’un développement local intégré qui répond à la culture des lieux et aux besoins de la population. Une méthodologie de mise en réseau articulant la cinquantaine d’associations locales, les institutions étatiques et des partenaires extérieurs est élaborée autour d’une action concrète de restauration pour crédibiliser et donner une résonance nationale et internationale au site.
En grande partie abandonné pendant la décennie 1980 au profit de la ville nouvelle, sur la rive opposée, le ksar sombre lentement dans la ruine bien qu’une dizaine de maisons continuent d’être habitées. Mais, parce que c’est un lieu religieux important, tous les vendredis les anciens lignages s’y rendent, prouvant l’intérêt de la population pour le lieu et dénotant un rapport à la mémoire locale particulier à l’oasis. Aussi, en 1990, 1998 et 2002, des restaurations de monuments religieux sont réclamées par la population. Malheureusement, exécutées avec un grand mépris de la qualité du bâti ancien et de la culture des lieux, réputés archaïques, trois mosquées sont remplacées par des édifices en ciment de béton qui reprennent les formes simplistes de la banlieue de Casablanca comme référence à la modernité.
La première étape du projet d’Assa fut de recréer le rapport au chantier et à la compétence d’édifier. Des maalmines originaires des régions environnantes sont guidés par l’architecte dans une démarche archéologique de redécouverte des formes et des procédés constructifs locaux. L’indispensable maîtrise des matériaux et leur mise en œuvre sont nécessairement associées à la volonté de préserver ces édifices. Or, même lorsque les maîtres constructeurs (maalmines) connaissent les modes constructifs, ils ne suivent pas toujours les règles de l’art. Les mutations contemporaines ont transformé leur approche, ont déplacé les hommes, ont brouillé les repères. La perte de confiance dans le patrimoine bâti ancien s’est inévitablement accompagnée d’une perte des compétences et des savoir-faire. Sur le chantier, les doyens sont invités à accompagner le travail mis en œuvre pour retrouver les procédés et reconstruire un lieu proche. Le travail s’inscrit dans la tradition architecturale locale.
L’architecture est un levier pour dynamiser la culture des grandes cités présahariennes. La restauration des murs devient un moyen permettant une réappropriation des lieux et l’émergence de pratiques qui font le lien entre la tradition et la contemporanéité, en revalorisant le passé, donc une culture et une identité garantes de l’avenir.
Salima Naji