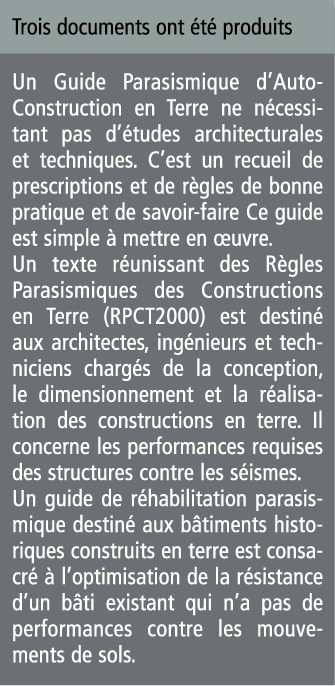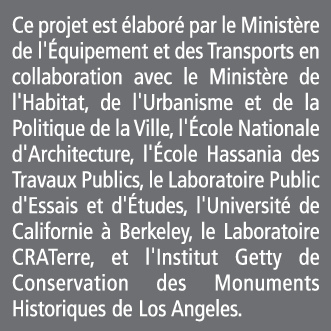La construction traditionnelle est parasismique

Tayyibi Abdelghani, architecte urbaniste, responsable de l’École Nationale d’Architecture de Marrakech
Le matériau terre est souvent pénalisé et désigné comme étant la principale cause de l’effondrement des bâtiments confrontés aux tremblements de terre. Son image est ternie du seul fait que sa résistance à la compression et à la traction serait inférieure à celle des bétons de ciment. Or, si les paramètres d’évaluation changeaient, on découvrirait bien des atouts…
Dans le cas du Maroc, des efforts importants ont été fournis depuis le tremblement de terre survenu à Al Hoceima en 2004 pour réglementer les constructions utilisant le matériau terre. La prise de conscience de l’importance du patrimoine bâti traditionnel se fait jour, ainsi que la reconnaissance des valeurs intrinsèques du matériau et des intelligences qu’il porte.
Le Règlement Parasismique des Constructions en Terre (RPACTerre 2011) qui vient d’être approuvé par le Conseil du gouvernement marocain le 23 mai 2013, relatif à l’utilisation du matériau terre dans la construction en zones sismiques, apporte une avancée historique au Maroc. Il comble un vide juridique en complétant les dispositions du règlement de construction parasismique RPS 2000 spécifique aux matériaux conventionnels.
Le nouveau chapitre présente une comparaison des 13 normes parasismiques dans le monde, dont le nouveau texte marocain en cours de publication au Bulletin Officiel. D’après tous les documents, les systèmes constructifs, quels qu’ils soient, ne prennent pas en charge les voûtes et les dômes, mais uniquement les murs.
L’étude des normes et des codes dans le monde montre une évolution notable des connaissances scientifiques et techniques du matériau, particulièrement en ce qui concerne la réaction des bâtiments en terre aux charges sismiques, l’identification des défaillances et les emplacements éventuels des renforcements. Elle révèle aussi la richesse et la diversité des démarches, les apports de chacune et leurs particularités (détails constructifs par exemple).
Les réglementations diffèrent également d’un pays à l’autre, selon les traditions et les cultures. Ce sont précisément ces différences qui sont riches d’enseignements.
La comparaison entre les normes des États-Unis – très succinctes – et les normes péruviennes – mûrement étudiées et approfondies – sont à cet égard explicites. D’une manière générale, les documents, qu’ils soient techniques ou scientifiques, démontrent que les prescriptions normatives sont étroitement liées aux contextes culturel, économique et social. En revanche, le non respect de leur application peut avoir des effets désastreux.
Tel est le cas des normes néo-zélandaises, ignorées aussi bien par le public que par les pouvoirs publics, ce qui compromet le financement et la sauvegarde du parc existant. Ces normes, pourtant très détaillées, ne sont accessibles qu’à une classe éduquée et aisée, excluant ainsi un public plus large qui vit dans un habitat en terre.
On assiste à un phénomène similaire au Maroc, où le besoin de protection du public concerne davantage les milieux non solvables. Il est donc nécessaire de produire des recommandations et des règlements simples, souples et économiquement accessibles.
S’agissant de la réglementation marocaine, le règlement RPAC Terre 2011 affiche des objectifs ambitieux : le respect des cultures et de la diversité architecturale, ainsi que la promotion d’un habitat écologique et responsable. Ce règlement, conçu en trois volets, se veut flexible et facile à appliquer pour justement répondre aux données socio-économiques, techniques et technologiques actuelles, à court et à moyen terme dans le milieu rural, permettant notamment de ne pas avoir recours systématiquement à l’architecte et à l’ingénieur.
L’analyse des 13 textes normatifs nous amène à faire les remarques suivantes :
Consensus autour de la stabilisation de la terre au ciment (Terre-ciment)
À l’exception de la norme IBC qui émet une réserve sur les réactions potentielles que provoque le mélange de la terre au ciment, eu égard à la non compatibilité des composants des deux mélanges.
Enduits au ciment proscrits
La majorité des normes recommande, voire exige, l’utilisation d’enduits de ciment sur les murs en terre dans l’optique d’en renforcer la durabilité. Or, ce type d’enduit forme des barrières de vapeur qui causent une rigidification du mur vis-à-vis de l’humidité (2, 5 d’épaisseur équivaut à un U.S. Perm ou moins), ce qui est fortement proscrit, notamment pour les murs non stabilisés. Ceci fait en sorte que les enduits de ciment endommagent et détruisent les murs sous-jacents en captant l’humidité.
Enduits à la chaux prescrits
Par ailleurs, il est bien établi qu’une addition de chaux à l’enduit augmente radicalement la perméabilité à la vapeur et la maniabilité des enduits.
Au Maroc, on utilise traditionnellement les mélanges d’enduits avec des parts importantes de chaux.
Aux États-Unis, la chaux est ajoutée à la majorité des stucs prémixés : les normes autorisent une part de chaux pour une part de ciment pour les enduits extérieurs, alors qu’une part de chaux pour quatre parts de ciment en renforce la perméabilité à trois US Perms ou plus.
Les analyses techniques de renforcement à revoir
Les mêmes méthodes d’analyses techniques établies pour le renforcement du béton et de la maçonnerie en béton sont appliquées aux murs de terre renforcés ou non renforcés. Or, de nombreuses études ont démontré que les similarités sont limitées. La résistance des matériaux en terre et l’adhérence aux barres de renforcement varient considérablement, et ce, également dans un même bâtiment. Les hypothèses techniques fondamentales telles que la contrainte proportionnelle à l’effort ou les sections planes qui demeurent planes sont à reconsidérer. Les structures soumises à des charges sismiques perdent leur qualité élastique et se comportent de manière plus complexe (plastique, visco-plastique, etc.).
Les textes réglementaires sont en faveur de la promotion et du renouvellement des techniques constructives associées au matériau terre. En revanche, la réhabilitation intégrée des savoir-faire et de la capacité d’innovation, respectueuse des modes de construction et des patrimoines, reste à démontrer.
À l’exemple des normes et des codes étudiés, le Règlement RPACT 2011 soulève quelques réserves :
1- Les matériaux et les systèmes constructifs préconisés par les normes et les règlements dépassent les moyens des populations concernées. Ces textes en décalage avec leur environnement économique sont, par conséquent, difficilement applicables et les exigences attendues compromises.
La complexité des textes normatifs et réglementaires sont un obstacle pour leur compréhension, leur maîtrise et leur application.
2 – Pour le cas du Maroc, il n’existe pas de textes qui réglementent la construction en terre qui soient antérieurs au texte qui vient d’être élaboré.
3 – Les textes réglementaires et normatifs standards sont dissociés de la composante culturelle. Ils tendent à généraliser des solutions techniques et à stéréotyper la construction en raison de l’objectif qui ne cherche qu’à contrôler la stabilité technique. Les spécificités régionales et locales se voient menacées de destruction irréversible. Pour le Maroc, même si le premier texte de la réglementation de construction parasismique en terre était simple et général, le deuxième illustre les craintes soulevées plus haut. Une étude des typologies architecturales de trois régions – Tadla-Azilal, Al Hoceima et Ouarzazate-Zagora – a pourtant été bien menée avec l’objectif d’intégrer les intelligences parasismiques traditionnelles dans les propositions réglementaires.
En conclusion, les textes réglementaires sur le matériau terre n’aplanissent pas tous les obstacles.
Tayyibi Abdelghani
Prof. Ing. Hamid Bouabid
Doctorante Bouasria Karima