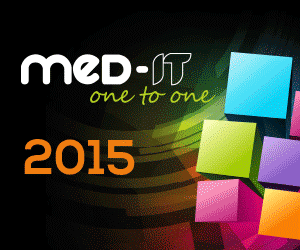Bois traditionnel en Architecture

Hassan Cherradi
Anthropologue, Muséologue, Inspecteur régional
des Monuments Historiques et des Sites du grand Casablanca
Au Maroc, quatre espèces de bois sont particulièrement utilisées : l’arganier, le peuplier, le cèdre, le plus recherché car séché il résiste aux intempéries, et le thuya employé dans la marqueterie, le mobilier et les instruments de musique. Art centenaire qu’on retrouve aussi bien dans l’architecture que dans le mobilier. Le bois a permis de réaliser un grand nombre d’œuvres remarquables au cours des grandes périodes dynastiques du Maroc.
Dès le IXe siècle apparaît avec les Idrissides un style de boiserie s’inspirant de l’orient, notamment de Damas et de Kairouan. Citons parmi ces influences orientales, des formes réalistes comme les grandes feuilles persanes ou la calligraphie koufique. Aux XIe – XIIIe siècles (sous le règne des Almoravides et des Almohades), apparaissent les influences hispano-mauresques. C’est entre le XIVe et le XVe siècle que le travail du bois atteint son apogée, intégrant abondamment le cèdre et l’aspect esthétique aussi bien dans les bâtiments religieux (medersas, zaouïas, mosquées) que dans l’architecture civile (palais, hôpitaux etc.). Ces traditions vont se perpétuer jusqu’à la période Saadiennne et Alaouite et ce en dépit de l’impact décoratif ottoman et de l’introduction de la peinture.
En dehors des influences venues soit de l’extrême Occident ou de l’Orient, les ébénistes marocains ont su créer un style original et leur école dite souvent « andalou – maghrébine». Fès est la première ville marocaine à prodiguer un encadrement et un encouragement à l’art du bois. Près de la capitale spirituelle, Meknès se trouve à proximité de la chaîne du Moyen Atlas couverte par d’abondantes forêts. Au XVIIe siècle, en choisissant Maknassa-Zaytoun comme capitale de son royaume, Moulay Ismail donna un essort à cet artisanat. Les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes, les décorateurs, les tourneurs bâtissent, meublent et enjolivent palais, médersas et mosquées avec des entrelacs géométriques, des rinceaux de feuillage, des arabesques, des calligraphies cursives ou maghrébines, des moucharabiehs élégants et hauts en couleurs.
Le travail du bois au Maroc utilise quatre techniques :
-Mkharatt : la technique du tournage grâce à laquelle on obtient le moucharabieh ;
-Mkhannak : la technique par défoncement : c’est un style de sculpture qui se faisait par panneaux;
-Mkassar : la taille chanfreinée ;
-Mkallaç : la technique évidée légèrement.
Puis on décore les objets avec une arabesque, c’est-à-dire des ornements ou des motifs en formes de lettres, de lignes ou de feuillages entrelacés. Autrement dit, il s’agit de courbes et de contre-courbes symétriquement répétées résultant de la stylisation de motifs végétaux.
Quant aux décors, ils se résument à cinq formes :
– Tastir : décor géométrique couvrant, polygonal à base de droites ou à polygones étoilés ;
– Tawrik : décor floral à base de rinceaux et de fleurs (ark : racine, rinceaux) ;
– Tachjir : décor végétal plus spécifique à la décoration polychrome ;
– Mokarnass ou Mokarbass : décor à trois dimensions communément appelé décor à stalactites ou à lambrequins ;
– Enfin, le décor calligraphié ou épigraphique, qui se fait par les inscriptions et l’écriture soit koufique, cursive, naskhit ou andalou-maghrébine.
Généralement, on distingue trois types de pièces en bois :
1. Le bois d’architecture : à travers les frises, les linteaux, les corbeaux, les charpentes, les plafonds, les panneaux et les portes à double vantaux. Dits en arabe classique « tonof » et en dialectal marocain « nâal al halqa », les corbeaux ; (un corbeau se pose en saillie sur le parement d’un mur pour supporter une poutre) sont souvent en bois de cèdre sculpté. Ils ont été employés depuis le XIVe siècle dans l’architecture massive des villes traditionnelles dont la population a construit avec la brique. Pour alléger l’impression de lourdeur des bâtisses, les maâlems utilisaient tout un système couvrant, dont les corbeaux de 1,08 X 0,113 X 0,30 de dimension présentent un beau spécimen. Quant à leur décor, il est composé des éléments floraux de la tradition mérinide : rinceaux, palmes et fleurons. L’originalité des corbeaux vient à la fois de la taille profonde des motifs qui permet de dégager les volumes et de ses pommes de pin hyperréalistes. C’est pourquoi la quasi-totalité des corbeaux prend la forme de palmettes ou de coquillages renversés.
Les portes et les volets étaient souvent doubles, en bois sculpté et peint. Leurs dimensions varient avec un décor couvrant géométrique. Les panneaux de ces volets étaient couverts par des entrelacs de deux types d’étoiles, à 8 ou à 16 branches, qui découpent tout un ensemble de petit modules chacun portant un nombre propre d’origine végétale. Les baguettes sculptées en léger relief sont soulignées souvent de jaune, les baguettes torsadées de l’encadrement sont vertes et les petits modules sont en rouge, vert ou blanc. Construites souvent de planches de cèdre ou de thuya, jointes et serrées à l’aide de pentures ouvragées diverses, les portes marocaines étaient autrefois pivotantes sur les tourillons qui prolongent leur montant. Pour le passage ordinaire, une petite porte de guichet appelée « khokha » est ouvert dans le vantail. Quant à la fermeture, elle a été assurée par un système comprenant un loquet, un verrou et une serrure. Parfois, un chevron à tirette logé dans le mur et qui sert de sécurité supplémentaire. Pour entrer, il convient de frapper avec le petit heurtoir du guichet qui est en même temps l’organe qui actionne le loquet intérieur.
Dans le bois d’architecture, on distingue aussi les fenêtres géminées : Il s’agit des panneaux qui dépassent 1,50m de dimensions en bois tourné et rapportées avec fenêtres au centre. Ces dernières se composent d’une double arcature en fer à cheval reposant sur une colonnette centrale en forme de fût pincé par une bague et rainurée, et deux demi-colonnettes arrangées ou étranglées. Ces grands panneaux comportent plusieurs registres rassemblant les bandeaux de baguettes géométriques entrelacées où revient régulièrement le seau de Salamon, les rinceaux et les palmes sculptées. Le décor est généralement avec eulogie pieuse. En bas et en haut des fenêtres se trouvent le moucharabieh. Les écoinçons des arcatures sont ornés de petites palmes. En haut, au milieu, le Coufique carré se détache pour glorifier le nom et la bénédiction de notre prophète : « Baraka Mohammad ». S’il n’y a pas beaucoup de fenêtres, on trouve cependant les arcs à stalactites imitant la sculpture sur plâtre. Ils se caractérisent par des motifs floraux et géométriques, peinture et dessins admirables. Ces arcs servaient à orner l’entrée des salons de réception ou d’alcôves (Koubba).
2. Le Bois sacré ou religieux : à travers les chaires à prêcher, les paravents, les bibliothèques des mosquées et des portes etc. Il s’agit des Minbar en bois sculpté et peint. Souvent de 3,60 m de hauteur, de 3,30 m de longueur et de 85 cm de largueur. La chaire comprend souvent huit marches (quatre pour les petites) avec une pomme tournée à chaque angle. Dans la partie supérieure, une arcature ornée d’un polygone étoilé. Sur chaque côté de la plus haute marche qui forme siège, deux arcatures outrepassées qui sont reliées par deux bras à une grande arcade qui prend assise sur la marche la plus basse. En ce qui concerne le décor, il est fait d’un assemblage de pièces de bois sculpté de motifs floraux dans un réseau de pièces peintes souvent rouge ou ocre. Les contremarches sont ornées chacune d’étoiles meublées de moucharabieh. Le paravent, appelé en arabe classique « Maqsûra » et en dialecte marocain « Aânza » est une sorte de mihrab en bois sculpté et discrètement peint indiquant la direction de la prière. D’habitude, on l’installe dans la première partie de la cour de la mosquée pour séparer l’endroit du Roi. Dans la partie supérieure du paravent, on trouve plusieurs chapiteaux qui délimitent les registres de moucharabieh dans tous les alentours. La partie médiane comporte un guichet en arcade au milieu avec une porte. Au-dessus de ce guichet se trouve souvent une inscription en calligraphie qui porte un verset coranique.
3. Le bois profane ou domestique : à travers les coffres à vêtement ou à bijoux, les tables (miyadi – tbiqa), les étagères, les armoires…etc.
Aujourd’hui, les plafonds de cèdre disparaissent dans les médinas du Maroc, les portes en bois sont remplacées par des portes en fer. Le heurtoir a fait place à la sonnette. L’artisanat est en perte de vitesse. L’art du bois suit la période de décadence. Il a fallu attendre deux grands événements : le premier au début du XXe siècle avec le Protectorat français qui crée les premiers musées du Maroc (Batha, Oudaias, Dar Jamai etc.). C’est ainsi qu’un grand nombre de pièces de bois gravé, sculpté ou peint est rassemblé et constitue le fonds des collections nationales. Le deuxième événement est l’essor donné par feu le roi Hassan II à l’artisanat marocain à travers la construction de la Mosquée Hassan II.En fait, les menuisiers, les charpentiers, les ébénistes et les décorateurs reprirent les meilleures traditions marocaines pour bâtir, meubler et enjoliver ce monument. Faut-il attendre un troisième événement afin d’assurer un meilleur avenir à cet art traditionnel ?
Hassan Cherradi