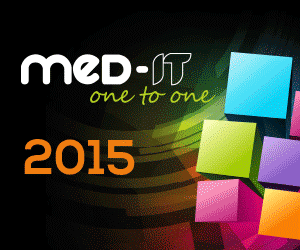Dakhla, ville enchantée
Coincée entre le désert immense et un océan furieux, la ville de Dakhla apparaît de prime abord comme un véritable miracle. Comment les hommes ont-ils pu fonder une ville dans ce lieu hostile où le vent ne cesse jamais de souffler ? Comment ont-ils pu apprivoiser les éléments dans cette lagune du bout du monde ?
Quand on découvre Dakhla pour la première fois et qu’on interroge ses habitants, ils ne manquent pas de vous faire remarquer l’incroyable évolution qu’a connue la ville. Comprendre la naissance de la Dakhla moderne, c’est en effet interroger l’évolution de toute une région : fin du nomadisme, évolution du rapport de l’homme à la nature et l’importance de la volonté politique. Questionner l’émergence d’une ville comme Dakhla, c’est découvrir le lien quasi mystique que l’homme entretient avec son environnement dans une des régions les plus belles et les plus mystérieuses du sud marocain.
Ancienne colonie espagnole, qui portait alors le nom de Villa Cisneros, le site de Dakhla a d’abord abrité une des étapes de l’aéropostale, entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal. Saint-Exupéry, qui y a séjourné, parle de la Villa Cisneros comme d’un minuscule groupement de masures sommaires, battues par les vents. En 1927, il décrit dans une lettre « ce fort espagnol baigné de lumière jaune ». N’y vivaient alors que quelques membres de tribus de pêcheurs et des aventuriers européens, avides de découvrir les grandes routes caravanières. À partir des années 1930, la colonisation espagnole n’a pas constituer un véritable palier dans le développement de la ville. Dakhla est restée pendant longtemps un simple village, à l’écart des grands axes. De cette période, on ne trouve que de maigres traces : l’église catholique, édifice blanc tout en simplicité, la caserne et une partie des fortifications, sans oublier le phare d’Arcipèse construit en 1889, qui fut pendant la période coloniale, le plus grand de tout le continent.
Aujourd’hui, pourtant, il ne fait pas de doute qu’une véritable culture urbaine s’est installée. La ville, avec sa corniche flambant neuve le long de la lagune, est propice à la promenade. Le centre-ville, qui a été aménagé, permet de valoriser la longue tradition commerciale de Dakhla. Sur la « place des Sénégalais », des Africains et des gens du cru vendent des tissus colorés, des épices et des onguents venus de toute l’Afrique. On a souvent tendance à croire que l’urbanisation étouffe les traditions et qu’elle uniformise les modes de vie. Mais ici, c’est tout l’inverse qui se produit. La ville permet à cette culture nomade, insaisissable et pudique, de trouver un espace d’expression. On y découvre l’artisanat propre aux peuples du désert. On s’y passionne pour la musique, mais aussi pour cet art de vivre tout à fait particulier, qui tourne autour du plaisir de recevoir et de la gastronomie.
Mais, la ville, comme partout ailleurs dans le monde, est aussi un facteur de destruction du paysage. Activité économique, tourisme, pollution, transport, tous ces éléments qui participent au développement sont aussi ce qui menace un écosystème. La baie de Dakhla est un site extrêmement fragile. La gestion des eaux usées, la promotion immobilière et la pollution, menacent la lagune ainsi que l’existence même de la faune et de la flore qui y prospèrent.
C’est pourquoi aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire que des hommes de bonne volonté, architectes, géographes, scientifiques ou amoureux de la région, se penchent sur le destin de Dakhla. Il est primordial que s’engage une véritable réflexion, à la hauteur des enjeux, pour réussir à conjuguer bien-être économique et protection du site. Sans cela, il y a fort à parier que demain, ceux qui visiteront Dakhla parleront comme d’une légende de cette ville où il faisait bon vivre et où la vie des hommes se nourrissait de la splendeur des lieux.
Leïla Slimani