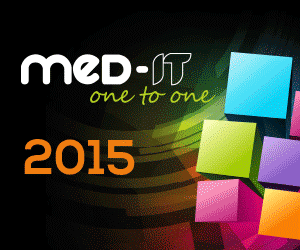Les igoudar sont-ils vaincus ?
En sillonnant les montagnes de l’Anti-Atlas lorsqu’on emprunte la voie goudronnée, nul ne peut imaginer que derrière ces hauteurs abruptes et dans ce paysage aride, se dressent solitaires, loin des regards, des fortifications immenses qui ont très longtemps protégé la population autochtone des différents aléas de la vie et du temps, mais qui maintenant, sont tombées pour la plupart dans l’oubli : les igoudar.
Qui aurait cru que ces greniers-citadelles, qui faisaient autrefois la fierté des villageois et des régions, qui leur procuraient sécurité et assurance pendant les périodes de disette et de guerre, édifices invincibles et inviolables pendant des générations, deviendraient aujourd’hui un lourd fardeau à entretenir aussi bien pour la descendance de leurs initiateurs que pour les autorités locales et les institutions publiques?
Dressés sur des pitons rocheux ou surplombant les villages, ces greniers collectifs que l’on appelle communément « Igoudar » (agadir au singulier) ou « Ighrem », étaient jadis de véritables institutions et jouaient un rôle primordial au sein de la communauté.
En effet, afin d’emmagasiner leurs récoltes et leurs biens ainsi que pour protéger leurs réserves en période de guerre, les habitants de plusieurs villages ou hameaux s’associaient pour construire ces greniers-citadelles aux architectures surprenantes. Le terrain était acheté en commun. Utilisant les matériaux locaux, toutes les familles participaient à la construction des parties communes de l’agadir (enclos, loge pour le portier-gardien, « lamine », moulin, forge, citernes emmagasinant l’eau de pluie, etc.). Par ailleurs, chaque famille construisait sa ou ses cases et assurait son entretien. Véritables constructions inexpugnables, les igoudar ne possèdent aucune ouverture sur l’extérieur (à l’exception des fentes d’aération). Seule une entrée en chicane permet l’accès à l’allée principale ou à la cour centrale autour de laquelle s’alignent sur plusieurs étages les cases closes par des portillons en bois sculpté dont seuls les propriétaires ont la/les clés. Des dalles de calcaire encastrées à moitié dans les murs permettent l’accès aux cases des étages.
De nos jours, la plupart de ces igoudar souffrent de plus en plus d’abandon et tombent en ruine. Les droits séculaires régissant le fonctionnement de l’agadir et son entretien ont disparu avec ces nouvelles générations qui quittent leur terroir à la recherche de conditions de vie meilleures et de revenu stable.
Des opérations de restauration ont été initiées par des associations, des architectes et autres défenseurs et mécènes du patrimoine bâti. Leur combat est à saluer, surtout que nous savons tous que l’obtention des fonds nécessaires pour de telles opérations est d’une grande difficulté. Cependant, en restaurant tel ou tel patrimoine, dans cent ans, sommes-nous certains que les générations futures se battront avec la même ferveur et la même ténacité pour sauver ce qui reste de ce patrimoine en agonie? La restauration du bâti est-elle la seule opération à entreprendre dans la région? Comment penser à restaurer dans une région mise à l’écart, sans aucun attrait? Une région où le souci primordial de la population est d’arriver à subvenir aux besoins du quotidien. Une réplique d’un villageois me vient toujours à l’esprit en visitant un « Agadir » de la région Souss-Massa, car je me désolais auprès des habitants de la disparition de la grande porte d’entrée du grenier abandonné et de celles des cases individuelles en expliquant que le fait de vendre ces objets aux touristes était une erreur. La réponse des villageois me laissa sans voix : les portes ont servi à nous chauffer durant les nuits d’hiver.
Alors, suffit-il de restaurer ou faudrait-il penser à une valorisation locale, régionale, voire nationale? Certes, le patrimoine subit une dévastation progressive, mais la région aussi. Une vision à moyen et à long terme du développement de la région favoriserait le développement du patrimoine culturel et attirerait les touristes locaux et internationaux.
Pour tout touriste intéressé par le patrimoine et passionné de découvertes, un tel voyage serait fascinant, à condition de répondre à ses besoins par un minimum de commodités et de services. Ce sont donc des investissements durables qu’il faudrait programmer dans le cadre d’un développement économique et social profitant aux populations locales. Sortons de l’approche nostalgique du patrimoine et pensons au développement durable.
Khaddouj Zerhouani
Photos : Aoubraim