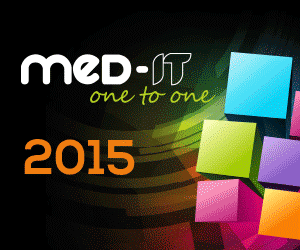COLLOQUE, DÉVELOPPEMENT HUMAIN DANS L’ESPACE JBALA TAOUNATE
Il y a plus d’un an, le Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires sur les Jbala (CERIJ-Groupe Jbala), en collaboration avec la Fondation Ibn Khatib, consacrait son colloque annuel à un bilan du patrimoine Jbala. Dans sa dernière édition tenue les 5 et 6 juin 2014, de nombreux chercheurs de différentes disciplines, ont repris la thématique « Patrimoine et Développement ». Compte rendu de Jacques Vignet-Zunz, chercheur passionné.
En réservant une demi-journée aux « Arts populaires », la rencontre de Taounate du 5 juin 2014 a donné l’occasion à des spécialistes confirmés de réfléchir ensemble aux moyens de faire profiter les populations de la Province des atouts combinés d’un héritage culturel multiple et du regard nouveau de l’élite intellectuelle du pays sur les créativités populaires.
Cette rencontre soutenue par les autorités de la Province de Taounate, présentes tout au long de la matinée, a été marquée par la conclusion d’un accord avec des architectes pour qu’un ou plusieurs édifices publics, cons-truits en matériaux locaux (améliorés par les techniques modernes), voient le jour dans le périmètre de la ville. Par ailleurs, cet évènement a permis de mesurer l’intérêt d’une entreprise comme celle du CERIJ-Groupe Jbala dans le développement d’une approche « militante » de la cause du patrimoine et de la collaboration entre disciplines, le sens du collectif et l’ouverture à l’autre.
Principales interventions :
L’architecture
La Province de Taounate présente un avantage certain en ce qui a trait à l’architecture vernaculaire. Elle englobe deux styles très différents et cependant également intéressants : la maison des Jbala et celle des Hyayna. La première, emblématique de cette population de montagne, quoique avec des particularités propres à la Province, est bien celle qu’on retrouve dans tout le Rif occidental, avec notamment son toit à double pente, recouvert anciennement de terre et de chaume. La seconde – toit plat en terre et chaume avec enduit argileux généralisé -, dans la plaine ondulée du Prérif, appartient aux Hyayna, une de ces tribus installées là à partir du XIIe siècle pour ceinturer les Jbala (appelés alors Ghumara).
Sur ces deux régions voisines, notons le regard de deux architectes amoureux de l’architecture de cette région : M. Benelkhadir et A. Lahbabi.
Leur étude, Architectures régionales. Un parcours à travers le Nord marocain (1989), est un document précieux sur les différents habitats du Nord. Elle a été par la suite resserrée sur les seuls Prérif et Rif central dans Architecture traditionnelle rifaine (2013).
Ana Julia Gonzalez Sancho, architecte établie à Tanger, a réalisé un important travail de recherche sur la maison Jbala (Rif occidentaux et central). Elle est également auteure d’une exposition itinérante, avec photos et dessins, dans diverses villes du Maroc et aussi à l’ENA de Rabat et de Tétouan. Ce contenu a été réuni dans l’ouvrage bilingue Architecture rurale en terre au nord du Maroc. Un Paysage culturel en transformation (2010).
Plus récemment, il y eut l’appel de l’Institut Culturel d’Architecture et du Patrimoine Maroc (ICAP), en mai 2013, nouvelle association créée à l’initiative de l’Ecole d’Architecture de Marrakech et de son directeur, Abdelghani Tayyibi. Cette entité vise à fédérer les énergies autour du thème de « la culture dans les domaines de l’Architecture et du Patrimoine », en ciblant les « activités pédagogiques, parapédagogiques, de recherches scientifiques appliquées et de sensibilisation liées à l’architecture, aux métiers de l’artisanat, du bâtiment et du patrimoine en particulier ».
Enfin, il est important de signaler le « Centre de la Terre », créé en 2000 par Denis Coquart dans la palmeraie de Marrakech et qui forme des maâlmins à la technique de la construction en terre, grâce à des méthodes scientifiquement éprouvées.
Il s’agit là d’indices qui ne manquent pas de révéler à l’association CERIJ-JBALA, que l’heure est sans doute venue de concentrer sur notre région du Nord, des compétences et des convictions toutes disponibles.
Musique
Comme l’a bien précisé Ahmed Aydoun dans son ouvrage de 1992 (Musiques du Maroc ; p: 111-115), le déroulement séquentielle d’une séance Aïta de Jebala est le suivant :
(1) un prélude instrumental improvisé et non rythmé dit ‘ar-rayla’, dont la fonction est juste d’annoncer les notes modales, (2) la ‘ayta’ au sens restreint qui consiste en un accompagnement mélodico-rythmique sur une mesure à neuf temps en cinq frappes, un rythme quinaire dit ‘goubbahi’ sur une mesure à cinq temps en quatre frappes (1-longue, 3-brèves), (3) un rythme divertissant final invitant à la danse dit ‘dridka’ sur une mesure à six temps en quatre frappes.
Ce à quoi l’on assiste aujourd’hui, sous la pression de l’accélération de la temporalité socio-économique et de la demande du marché de l’événementiel, axé sur le divertissement grand public, est une tendance à réduire le déroulement authentique de la ‘Aïta de Jebala à sa seule phase finale la dridka, interprétée sur des tempos de plus en plus rapides. Cela revient à dire que, faute d’une prise de conscience et d’une vigilance accrue aux niveaux de la gestion du fait culturel et artistique, la ‘Aïta de Jebala s’achemine, par la force de la seule logique de la demande du marché de l’animation artistique, vers la perte des éléments essentiels qui fondent sa spécificité musicale. Cette dérive de destructuration n’aura pas seulement des conséquences au niveau musical, vue à l’aune du patrimoine immatériel. Elle aura également, comme résultat de dépourvoir la ‘Ayta, en tant que musique traditionnelle, de tout son pouvoir d’encadrement socio-culturel, et ce en l’uniformisant dans le registre atone des variétés.
La poterie
L’association Terres des Femmes travaille avec plusieurs lieux de production de poterie chez les Jbala : M’tioua, Douar Taounate Louta – M’tioua, Douar Dlimet – Aïn Bouchrik – Aïn Berda – Douar Dehar – Douar Bouadel – Douar Ouled ben Kacem… Jadis, dans des douars entièrement voués à la production de la poterie, il ne reste aujourd’hui que deux ou trois femmes âgées produisant quelques pièces. Ces lieux ont une production diversifiée présentant un intérêt esthétique. Les influences ne semblent pas avoir touché l’essentiel de la morphologie des poteries ou de leur décoration. L’appartenance à une tribu, bien qu’elle perde graduellement de son importance, se maintient dans la mémoire des potières. Cependant, à chaque potière qui s’éteint, c’est un centre de production qui ferme à jamais !
Aujourd’hui, les bouleversements socio-économiques et culturels ont dénaturé la poterie et restreint la diversité des formes. La raréfaction de la production vient essentiellement de la prolifération dans les souks hebdomadaires de la vaisselle et des récipients en aluminium et en plastique plus légers et plus solides, et surtout bon marché. L’apparition de ces nouvelles matières a provoqué la disparition de certaines pièces trop lourdes (grandes jarres). Les pièces sauvées par les musées nationaux ne sont pas légion !