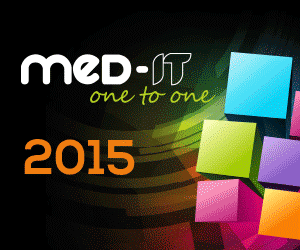QUELLE POLITIQUE POUR LA VILLE MAROCAINE AUJOURD’HUI ?
Il existe aujourd’hui un référentiel de la Politique de la Ville, produit d’un processus de concertation avec un certain nombre d’acteurs politiques, de la société civile et autres instances représentatives. Mais qu’est-ce que la ville réellement ? Est-ce une donnée démographique, une superficie, une concentration de services ? La ville est perçue plus véridiquement qu’elle n’est définie par les diagnostics et autres rapports technico-académiques.
L’intérêt porté aujourd’hui à la politique de la ville répond à une nouvelle préoccupation citoyenne dont découle celle, gouvernementale, de concrétiser un idéal de ville qui soit le plus homogène possible.
C’est en réalité une reconnaissance que la ville marocaine est hétérogène et souvent injuste envers certaines catégories de citoyens. Il est donc évident que dans le cadre des actions à mener, il est nécessaire de réfléchir sur le rôle et le fonctionnement de la ville à différents niveaux. Il ne doit pas être question de produire des bilans et autres études de l’existant, qui auront pour seule vocation de remplir les étagères de cette nouvelle direction du ministère.
La politique ministérielle en la matière doit proposer une construction. Dans un premier temps, à l’échelle infra-urbaine, il est question de savoir comment construire et intervenir sur les sous-ensembles dans un souci de cohésion urbaine. Dans une seconde échelle, urbaine, l’objectif est de rattraper les déficits de la ville en amenant les acteurs de l’urbain à penser autrement.
Or, les contrats de ville de première génération qui correspondent à cette échelle prennent aujourd’hui la forme globale de mises à niveau urbaines. Et ce, étant donné les problématiques urgentes de sous ou de mal-équipement au quotidien, qu’il s’agisse des déplacements piétons, motorisés ou des services de manière générale.
Enfin, la dernière échelle de réflexion n’est pas spatiale mais se penche sur la vocation évolutive, agricole, touristique ou autre d’une ville, en partant de la nécessité de doter celle-ci des aménités nécessaires. Il s’agit de concrétiser une nouvelle cohérence territoriale
entre les nouvelles villes projetées et celles déjà existantes et ceci fera l’objet des contrats de ville de deuxième génération.
Consolider l’armature urbaine permettrait dans un premier temps de hiérarchiser les villes, les unes par rapport aux autres. Et, dans un second temps, pour répondre à cette hiérarchie, les contrats de ville de troisième génération devraient agir sur les complémentarités entre les villes. Il en va évidemment de l’équilibre entre les régions, dont certaines agissent tant bien que mal sous les menaces des soldes migratoires négatifs, faisant chuter l’attractivité des régions et donc des villes les unes par rapport aux autres.
Aujourd’hui, les 80 conventions de la Politique de la Ville s’occupent essentiellement des VRD, de l’éclairage et discutent les mises en cohérences entre les secteurs de la santé, de l’éducation…
Entre les ambitions d’intégration dans un espace national, régional, puis urbain stricto sensu, et cette réalité qui met en évidence un déséquilibre territorial évident entre l’axe Tanger-El Jadida et le reste du Maroc, une marginalisation de régions les unes par rapport aux autres et enfin, une désagrégation des quartiers de la ville, tout est à faire.
Les intentions sont bonnes, les ambitions sont grandes et le chantier, ouvert.