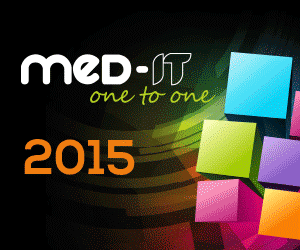Les Ateliers de la Terre
Comment garantir la sécurité alimentaire, la préservation des terres en Afrique ? Comment transformer les villes africaines en villes intelligentes ? Comment parvenir à la sécurité en eau sur le continent africain ? Comment développer et exploiter les énergies renouvelables ? Ces quatre thématiques ont soulevé beaucoup de questions mais ont aussi ouvert des perspectives d’avenir encourageantes dans le Forum international pour un développement durable, Maroc, les 18 et 19 septembre 2013.
Parler du continent africain dans son ensemble expose à des généralisations forcément inexactes.
De quelle Afrique parle-t-on en effet ?
Le Maghreb n’a rien à voir avec l’Afrique subsaharienne et l’Afrique de l’Ouest n’est ni l’Afrique du Sud ou de l’Est. Une petite gymnastique intellectuelle était nécessaire au cours de ces travaux pour identifier des situations et des problématiques très différentes, même si ces régions ont en commun un certain nombre de préoccupations.
Séance plénière N°1
Quel modèle agricole pour garantir la sécurité alimentaire et la préservation des terres en Afrique ?
Si pour l’agriculture se pose le problème complexe de concilier la protection de la filière nationale et d’encourager le développement économique à l’exportation, ce secteur est entièrement à relancer dans certains pays d’Afrique subsaharienne alors qu’il est l’un des moteurs de l’activité au Maroc.
Si la question de la préservation des terres agricoles est commune à de nombreux pays dans le monde, l’agro-carburant, insignifiant au Maroc, est encore peu développé en Afrique subsaharienne.
En revanche le développement urbain est partout une vraie question.
Peut-on pour autant revenir à une agriculture de subsistance pour stopper l’exode rural ?
Comment dans ce cas aller à contre-courant de l’évolution des villes de la planète entière ?
Les réponses faisaient défaut.
Faut-il former les petits agriculteurs pour améliorer la productivité et revenir à une production qualitative ?
Faut-il économiser l’eau et introduire des cultures adaptés aux conditions locales ?
Personne ne peut en disconvenir.
L’urgence est toutefois de nourrir la population de la planète terre dont la croissance démographique n’est pas près de reculer.
Séance Plénière 2, animée par Selma Zerhouni
Comment transformer les villes africaines en villes intelligentes ?
L’urbanisation et l’étalement urbain constituent un phénomène mondial mais comment évoquer l’aménagement durable, c’est-à-dire contrôlé, là où les services de base sont absents ?
La croissance de nombreuses mégalopoles est rarement synonyme de qualité de vie en ville.
Il est vrai que ce sont les projets structurants comme les transports qui changent les conditions de vie, voire réhabilitent, comme le tramway au Maroc, les notions d’aménagement urbain.
L’Afrique subsaharienne n’en est pas là… L’accès à l’eau y est, pour certaines populations, précaire, l’assainissement inégal, le tri des déchets pour la plupart du temps inexistant. On parle d’urbanisation de la pauvreté avec son habitat informel et le système D en guise de règles de fonctionnement.
Il est vrai en revanche que l’Afrique a sauté une étape en passant directement au téléphone mobile. La table ronde mettait en évidence le rôle de la poste en tant qu’opérateur en interface avec l’ensemble des acteurs de la ville. Elle est ainsi à même d’offrir un certain nombre de services via l’électronique : état du trafic, parking, horaires des transports, santé, consommation d’électricité.
Le gisement du service au particulier introduit par le mobile est effectivement énorme mais dans des villes déjà structurées.
Un intervenant faisait remarquer qu’il fallait aussi des hommes pour faire marcher une ville, c’est-à-dire des politiques, des élus responsables et des fonctionnaires formés et efficaces.
Il faut aussi établir des liens entre les politiques publiques et les fonctionnaires ou employés des entreprises privées, prestataires de services. Dans le Maghreb, le maillage des responsabilités politiques est en cours avec la décentralisation. C’est un levier effectif et efficace à condition d’être bien accompagné.
Au Maroc encore, les entreprises concessionnaires des services eau ou électricité ont équipé leur réseau de systèmes intelligents. Ainsi un dysfonctionnement est-il détecté, voire anticipé rapidement.
Rien ne sert de se décourager soulignait un intervenant. Il faut faire avec l’existant, même anarchique à condition d’avoir un orchestre et un chef, mettre en œuvre les projets dans la transparence et avec l’aide de la numérisation. La ville est un processus et le rôle de la bonne gouvernance est de fixer un horizon à atteindre.
La numérisation mais aussi la jeunesse dont dispose le continent dans son ensemble, une jeunesse avertie grâce à Internet, creuset des plus grandes potentialités.
Séance plénière N°3
Comment parvenir à la sécurité en eau sur le continent africain ?
Face à l’incurie de l’Etat, la solution de la privatisation a eu pour pendant la déresponsabilisation.
Personne ne sait qui fait quoi. Deuxième source de problème : dans un certain nombre de pays, les agriculteurs accaparent la majorité des disponibilités hydriques et ne payent pas ce qu’ils doivent à l’Etat. Reste que la question prioritaire est toujours l’accès à l’eau potable et l’assainissement, question qui ne peut se résoudre que par la volonté politique. Ainsi à 93% au Maroc, le fossé a-t-il été comblé.
Le changement est d’autant plus réalisable que sur ces thématiques les fonds seraient aisés à trouver. Malheureusement convaincre les bailleurs de fonds d’investir dans des régions reculées en Afrique subsaharienne, semble beaucoup plus compliqué. Résultat : ce sont les plus pauvres qui payent le plus cher. L’autre frein est d’ordre psychologique, il faut convaincre qu’en dehors du système D ou d’un puits, un service de distribution de l’eau est payant et peut être plus avantageux.
Comment faire aussi comprendre que l’eau du puits est un bien collectif en cas de rareté ?
La relation public/privé doit également être clarifiée : les contrats ne sont pas des rentes de situation et des systèmes de régulation et de contrôle doivent être mis en place.
A contrario, l’Etat ne doit-il pas aussi respecter ses engagements et le flou de certains processus de décentralisation a pour conséquence que les administrations ne tiennent pas compte des attentes des populations. Combler le déficit en termes de ressources humaines qualifiées et par conséquent de formation est sans doute l’une des clefs de la solution.
Il faut aussi mieux coller à la réalité d’un pays au lieu de chercher à appliquer tel quel un modèle venu de l’extérieur.
L’économie solidaire a sans doute dans ce domaine son rôle à jouer de même que les jeunes qui, bien informés, citoyens du monde, feront mieux entendre leurs attentes.
Séance plénière N°4
Quels leviers pour favoriser le développement et l’exploitation des énergies renouvelables en Afrique ?
Contrairement aux idées reçues dans ce domaine encore, à condition d’afficher une stratégie claire et un cadre visible, les financements ne sont pas un problème. Pour amorcer la pompe, rassurer sur la solvabilité du fournisseur local passe par la garantie de l’Etat. La mise en place d’instruments juridiques est aussi nécessaire pour racheter une partie de la production. La micro-finance offre des opportunités indéniables à condition de faire évoluer le cadre rigide et réglementé d’un pays comme le Maroc où il est impossible pour l’instant de vendre sa production. L’autre modèle envisageable est l’investissement à grande échelle dans une série de projets délocalisés via des associations et des coopératives. Dans tous les cas de figure, l’accompagnement, c’est-à-dire l’information, est une nécessité.
Tout projet bien préparé et expliqué a ses chances de succès. Le rôle des femmes est aussi essentiel car l’implication des populations dans une activité économique (machines à coudre, cybercafé) est une garantie de bonne gestion et d’appropriation. Quant aux technologies (photovoltaïque, panneaux solaires, biomasse etc…), il faut choisir une solution adaptée à chaque pays. Parler pour l’instant d’efficacité énergétique plutôt qu’économies d’énergie est donc l’étape préalable.
Florence Michel-Guilluy