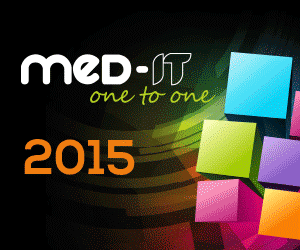La renaissance des Kasbahs
« L’objectif est de capitaliser sur le potentiel historique, culturel et architectural des kasbahs afin de développer un produit touristique authentique, de luxe et à forte valeur ajoutée » a fait savoir le ministre du Tourisme, M. Haddad Lahcen. Nous ne pouvons que souscrire à cette « vision » qui devrait faire d’une pierre deux coups, en préservant un patrimoine culturel et architectural et apporter une nouvelle activité touristique dans ces territoires ruraux.
Enfin ! Les kasbahs et les ksours, patrimoine unique au monde qui tombait jusqu’alors en décrépitude, sans que l’on s’émeuve de voir retourner à la terre notre mémoire architecturale et rurale, devraient être sauvés. Entre 300 et 400 kasbahs du sud du Maroc, pour la grande majorité en ruine, constituent les derniers vestiges de l’histoire rurale, tribale et guerrière du royaume. Aujourd’hui, le gouvernement ambitionne de revaloriser ces kasbahs en les destinant au tourisme haut de gamme, authentique et à forte valeur ajoutée.
Pour ce faire, la création de la Société Marocaine de Valorisation des Kasbahs (SMVK), dotée d’un fond de 130 millions de dirhams, devrait permettre d’acquérir, de rénover et de chercher des gestionnaires touristiques pour une dizaines de kasbah, à l’horizon 2020. Issue d’un partenariat public/privée, la SMVK, a pour actionnaires égalitaires : la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), le fond Madaëf (filiale de la CDG) et Akwa Groupe. Cette initiative entre dans le cadre de la « vision touristique 2020 », qui cherche à faire du Maroc, un pays de tourisme haut de gamme, plus qualitatif que quantitatif, culturel, authentique et respectueux des populations locales et de l’environnement. Preuve en est, le 23 juillet 2013, une cérémonie de signature de convention pour la valorisation des kasbahs s’est déroulée en présence du ministre du Tourisme M. Haddad Lahcen et des représentants des sociétés actionnaires, d’une part et d’autre part, les propriétaires des trois kasbahs choisies. Les premières bénéficiaires du programme sont la kasbah Aît Abbou à Skoura à coté de Ouarzazate, la kasbah Dar El Hiba à Zagora et le Kser Ouled Abdelhlim à Errachidia qui devraient être opérationnels d’ici 2016. Les candidats à la requalification de leurs kasbahs doivent répondre à un appel à manifestation d’intérêt avec un cahier des charges précis et pourront vendre, louer ou proposer un partenariat à la SMVK. Après rénovation, ces kasbahs seront confiées à des sociétés de gestion touristique spécialisées, en partenariat avec de grandes chaînes hôtelières. Le choix des kasbahs, éligibles à cette requalification se fait en fonction de critères bien définis comme l’intérêt du lieu, la valeur historique, les activités potentielles à proximité, l’état de la bâtisse, le cachet architectural ainsi que la facilité d’achat. En effet, les promoteurs de ce projet, expliquent se heurter à des problèmes d’acquisition, en raison notamment de problèmes d’héritage et du trop grand nombre d’héritiers à contacter.
En conservant ce lieu de mémoire et en y apportant une dynamique économique, sociale, et touristique, ces kasbahs peuvent retrouver une nouvelle valeur et être un motif de fierté pour les populations locales. Elle devrait permettre de redynamiser l’économie des régions du sud de l’Atlas en créant environs 150 emplois directs et indirects et de favoriser la découverte de ce terroir abandonné.
L’objectif affiché est de créer à terme, un circuit des kasbahs, pour inciter les touristes à découvrir les différentes typologies de ce patrimoine, ainsi que les nombreuses spécificités locales gastronomiques, culturelles et artisanales. Bien que ce projet soit à vocation nationale, la SMVK se concentre pour l’instant sur les régions de Ouarzazate, Zagora, Tinghir et Errachidia.
Il est souhaitable que ce projet de réhabilitation soit également l’occasion de sauvegarder les anciennes techniques et savoir-faire de la construction des kasbahs. Ces constructions vernaculaires sont de véritables démonstration du savoir-faire architectural bioclimatique et de l’adaptation au milieu environnemental des anciens bâtisseurs. Ces constructions durables d’avant l’heure, qui conservent en été une fraîcheur salutaire à l’intérieur grâce à l’épaisseur importante des murs en pisé et à la petite taille des fenêtres, recèlent des systèmes ingénieux de climatisation par système venturi ou captation des vents dominants (malquaf), encore méconnus. De plus, tous les matériaux utilisés étant prélevés à proximité, les architectes chargés de leur rénovation n’auront aucun mal à s’approvisionner en matières premières à moindre coût. La question de la mise aux normes de ces bâtisses aux exigences de confort et de sécurité modernes et particulièrement pour les établissements touristiques « haut de gamme » risque de poser problème. Le défi de l’adaptation de ces habitations vernaculaires sans confort, en hôtels de luxe, est une première et mérite une cellule de réflexion dédiée à cette problématique. Une fois l’effet d’annonce dépassé, la question technique de la rénovation et requalification en hôtel de luxe reste ouverte, autrement dit comment faire d’une vieille kasbah rurale en terre, un palace pour milliardaires ?
Jaafar Sijelmassi