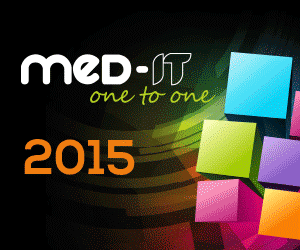Tanger Metropolis
Fortunes et infortunes d’une ville
Un écrivain n’est-il pas le mieux placé pour évoquer l’histoire mythique, voire onirique d’une ville qui par son ancrage à la croisée de flux pléthoriques, a de tout temps alimenté l’imaginaire ? Cet amoureux de Tanger souligne que sans mémoire, sans racine, mais aussi sans méthode et sans respect des règlementations en vigueur, sans un diagnostic intransigeant de ses dysfonctionnements successifs, aucune métropole ne peut envisager son avenir, ni celui de ses habitants.
Sur ses sept collines, qui sont autant de points d’observation d’où l’on peut admirer le merveilleux paysage du détroit, s’éparpille, vaste, irrégulière et chamarrée, la masse des maisons cubiques et des immeubles de tout genre qui compose Tanger.
Pour les voyageurs qui arrivent par la mer, la ville s’élève comme une séduisante vision onirique et se détache nettement contre le bleu vif du ciel que le soleil ravive de son or. Tout au long de la baie, des buildings de toutes les hauteurs dissimulent les quartiers de la cité moderne. Puis, progressivement, en avançant vers le port, ils commencent à apercevoir les édifices de style colonial et la fameuse médina, dense et blanche, aux murs vieillis, et dominée par l’illustre minaret octogonal de la kasbah, peint jadis par Matisse. Ce panorama est le plus beau de la ville. Car Tanger, vue d’autres lieux, présente une image plus contrastée due aux flétrissures des hommes.
De la colline du Charf, éminence qui culmine à cent mètres environ, la vue est totale. Le regard saisit l’espace gigantesque de la ville à 180°. Il suffit de tourner la tête pour contempler tout Tanger, ancienne et moderne, sublime et triviale, gracieuse et disgracieuse, riche et misérable, qui se montre dans la courbe de sa baie, depuis le cap Malabata, à l’est, jusqu’à la médina et le Djebel al-Kébîr, à l’ouest. Mais ce qui frappe le plus, c’est l’horizon infini des constructions populaires qui dévorent, au sud, les anciens champs et prairies et les lagunes asséchées qui redeviennent parfois, pendant la saison des pluies, de grands marécages. La colline du Charf, jadis boisée, qui dominait fièrement la cité, est elle-même rongée par l’urbanisation foudroyante. Dans ce fouillis de maisons se profilent le cercle régulier de la place des Arènes (Plaza de Toros) d’où résonnaient pendant les années 1950 les clameurs des aficionados de la corrida, les minarets des mosquées et le clocher de quelques églises. Vu de loin, même la ville moderne possède actuellement sa grande mosquée, et son minaret élancé surplombe les terrasses de la cité et dépasse de quelques mètres le clocher de la cathédrale espagnole.
Sur cette colline, on vient souvent s’asseoir pour contempler, face au détroit, une ville qui grouille, rêver d’un passé légendaire et surtout ruminer les idées et les projets pour faire face aux défis que doit relever Tanger de demain.
L’histoire si puissante et si violente de la ville du détroit, n’est-elle pas le reflet de l’extraordinaire croisement des flux de tout genre, des influences pléthoriques, de cette image sibylline et multiple, difficile à décrypter, impossible à comprendre dans sa totalité et dans son détail ? Tanger n’est-elle pas le condensateur spatial de cette inextricable histoire, de ce paradoxe parfois faste et parfois néfaste pour cette ville ?
L’indépendance retrouvée, Tanger connut un autre destin. Cinquante huit ans environ de gestion marocaine mérite un livre à part, car c’est une aventure qu’il serait trop long d’analyser ici. En somme, on passa d’une cité stable, la médina, à une ville internationale hétéroclite et relativement contenue, pour aboutir à une métropole indépendante, mais incontrôlée, où l’espace et le temps bouleversent aujourd’hui le rythme et les valeurs. L’urbanisme symbolique de la médina se transforma pendant le statut spécial en un urbanisme du signe, où le style recherché, inhérent aux esthétiques européennes et aux formes artistiques marocaines, réminiscences d’un passé glorieux, s’inscrivit dans les configurations composites de la cité. À l’indépendance, la ville se convertit en un phénomène du nombre. Le mouvement quantitatif devint le principe même de son ordonnancement. Tanger obéit naturellement à la propension universelle à l’urbanisation, qu’il est difficile, sinon impossible, d’enrayer. La croissance démographique est au cœur des préoccupations des responsables de la ville et du pays.
Jadis, l’architecture collective obéissait au principe de durée, car le bâti, tout comme la tradition, avait besoin de temps, de méditation pour mûrir, et de beaucoup d’attention pour trouver l’équilibre permanent entre espace et société. Le régime international libéra le sol pour lui octroyer le statut de marchandise, et introduisit le système d’immatriculation foncière. Il institua surtout une société libérale capitaliste sans contraintes réglementaires rigides. Dans ce contexte, de nombreux architectes déployèrent leur talent dans une ville nouvelle qu’ils façonnèrent de toutes pièces. La métropole improvisée mais relativement contrôlée étale cette pléthore de créativité et cette hétérogénéité de styles. À chaque débordement, un effort de planification et d’emprise sur la ville fut tenté, afin de contenir et de corriger les écarts. Tanger l’Internationale fut une chance pour ces techniciens, qui gardèrent toujours du respect pour l’art de bâtir et marquèrent leurs diverses expressions artistiques dans l’espace architectural. Une lecture de ces édifices constitue toujours une sorte d’introspection dans l’histoire de cette ébullition inventive formant la mémoire de la ville.
L’abrogation du régime spécial de Tanger, en 1956, signa obligatoirement la fin d’une ère. Les Européens et les Juifs qui composaient près de la moitié des Tangérois vers le début des années 1950 quittèrent promptement la ville. Ils étaient encore un peu plus d’un tiers en 1959. Mais en 1982, ils n’étaient plus que 3 % et en 1990 à peine 1 %, sur une population qui avait dépassé les 400 000 habitants. Le départ de plus de 50 000 Européens et Juifs n’empêcha cependant pas la ville de connaître sa plus grande explosion démographique de l’histoire.
Cette extension prodigieuse de Tanger, qui de 20 000 habitants en 1913 passa à plus de 150 000 en 1956, à l’indépendance du Maroc, à 200 000 en 1982, à 405 000 en 1991 et enfin à plus de 1 000 000 aujourd’hui. Ce chiffre me paraît loin de la réalité ! Visuellement, le cadre bâti semble combler le paysage, car les lotisseurs construisent partout. Cette instabilité ininterrompue est une fuite en avant irrépressible, qui génère des problèmes cruciaux que personne n’arrive ni à régler ni à prévenir.
La médina de Tanger n’est pas encore un espace-musée, non plus qu’un quartier en voie de défection et de marginalisation inévitable. Plus que les villes impériales, la médina a été valorisée par le regard de l’étranger, touriste ou résident de longue durée. Elle bénéficie surtout de son passé et de la beauté de son site, mais aussi du fait commercial et spéculatif des riyâds dans les autres villes marocaines, et notamment à Marrakech. Pourtant, dans la médina de Tanger, les étrangers ne trouvent guère de demeures avec patios et jardins intérieurs, ils acquièrent plutôt des maisons extraverties, dominant le détroit. De ce fait, certaines résidences de la kasbah et celles bâties face à la mer sont vendues aux Européens et aux Américains. Ce phénomène qui a ses limites rehausse néanmoins la qualification de certains quartiers de la cité historique aux yeux d’une partie de l’élite marocaine.
Mais l’ancienne ville, plus ou moins stable et bien définie dans ses murailles, est aujourd’hui en péril. Les Européens l’avaient déjà phagocytée au début du XXe siècle. Le visiteur d’aujourd’hui est désolé de voir dans certains vieux quartiers l’état des anciennes demeures aux murs parfois lézardés et délabrés. Aussi, la construction en hauteur au sein même de la médina affecte sérieusement sa grâce. La hauteur des maisons, qui atteint parfois six étages, rivalise actuellement avec les minarets des grandes mosquées.
Ce sont des habitants humbles qui résident maintenant dans ces maisons, et seules les grandes demeures qui ont vue sur mer ou celles sises dans la kasbah ou proche du port ont été rachetées par des étrangers fortunés pour être restaurées et préservées du dépérissement. Elles constituent désormais un contraste éloquent avec le reste du tissu urbain aux aspects quelquefois insignifiants.
Les infortunes que Tanger subit depuis 1956 sont tout particulièrement la fulgurante hausse démographique et la dilatation spatiale. La ville attire non seulement les ruraux, mais aussi les citadins pauvres des autres régions du Maroc. Elle croît sans cesse et repousse ses limites à l’infini. L’urbanisation récente vers le sud et l’ouest de la cité, la multiplication persistante de lotissements improvisés ou programmés par l’État, constituent un préjudice quasi irrémédiable, qui s’étale sur les belles collines d’antan et les prairies envahies de partout par les petites maisons cubiques semblables et confuses et les immeubles à prix modérés que les spéculateurs ont acquis avec beaucoup d’appétit et revendu en s’octroyant des bénéfices importants. Les prix réels des appartements ne sont jamais déclarés au fisc. Les centaines d’hectares bâtis en quelques années obéirent peu à des règles d’urbanisme. Les immeubles et les maisons construits n’expriment guère de créativité architecturale et de normes esthétiques, qu’elles soient anciennes ou modernes. Les lotisseurs fabriquent des maisons ou des immeubles standardisés, des machines à habiter, comme dirait Le Corbusier, avec une façade quasi identique qui évoque à l’infini l’éloge de la monotonie. Les lotissements de Beni Makada, le quartier des fonctionnaires, Hawmat el-Mouadhafîne, le secteur édifié par les Marocains résidant à l’étranger Hawmat Belgiga, le lotissement Hawmat ech-Chouk (les épines) qui a gâché l’élégante colline du Charf, autrefois boisée et dominant fièrement la baie de Tanger, tous les lotissements récents surgis sur la route de l’aéroport, les dites « villes nouvelles », et d’autres encore… déprécient le paysage urbain.
Tanger hérita de l’époque internationale un plan et des documents d’urbanisme modernes faits par de grands professionnels, mais dont la mise en œuvre ne fut guère appliquée en raison de multiples dysfonctionnements. Ses principes furent fondés sur le concept de « zoning », accordant des fonctions distinctes aux espaces urbains et créant ainsi de vraies écluses spatiales et des ségrégations économiques et sociales. Ce concept fondé pendant le régime spécial fut reconduit, car juste après l’indépendance, et plus exactement en 1963, un plan d’aménagement général fut approuvé par la nouvelle administration marocaine. Ce plan poursuivit, avec des modifications, les grandes orientations d’urbanisme proposées par les lauréats du concours d’urbanisme de 1948 peu ou pas connu des responsables d’aménagement de la ville. Mais sous la pression de l’urbanisation et de faibles moyens d’action financiers et institutionnels, aucun plan ne pouvait résister au poids de l’essor vertigineux de la ville. Souvent dans le détail, les règles de la cohérence urbaine et architecturale ne furent guère observées. Dans la plupart des cas, les zones destinées à recevoir un type de bâtiments ayant un certain nombre de fonctions spécifiques subirent des dérogations pour accueillir d’autres activités et d’autres édifices. Pis, la hauteur des maisons ne fut pas respectée. Dans des zones réservées aux villas, des immeubles surgirent pour rompre l’homogénéité des espaces, et dans les quartiers populaires, la hantise perpétuelle de rajouter des étages est très dépréciative, ce qui brise l’équilibre entre le plein et le vide et les proportions des volumes. Une rue prévue pour deux niveaux ne peut en supporter plus, car le paysage urbain devient abominablement saturé.
Un autre phénomène important pour la ville, les gros profits provenant du trafic du kif eurent un impact considérable sur la morphologie de la cité pendant une vingtaine d’années (entre 1975 et 1995). Dans tous les quartiers apparaissent les séquelles insolites de cette période. Des immeubles de taille gigantesque non prévus par les documents d’urbanisme surgirent dans le centre et sur la baie, des villas rococo, des palais composites dignes d’un décor hollywoodien affichent des toits de style asiatique, des façades bâtardes avec colonnes hellénistiques et chapiteaux en tout genre et des compositions où toutes les formes se jouxtent et se croisent sans souci de créativité et sans références esthétiques nationales ou internationales. Les intérieurs sont d’une surcharge ornementale inouïe. Le vocabulaire hispano-mauresque est placardé à l’excès et dans la démesure. Il n’y a point de jeu entre le vide et le plein, entre le silence des formes et la mélodie des ornements. L’horreur du vide est une constante dans cette mode des nouveaux riches. Et les architectes dociles ont tout fait pour plaire, sans se soucier du développement d’un nouveau style architectural et artistique.
Objet d’une modernité espérée, la ville de Tanger est actuellement à la recherche de son éclat. Car elle est obnubilée par son long passé jalonné de périodes fastes et d’autres qui le sont moins, de fortunes et d’infortunes. Tanger, qui essaie de renouer physiquement avec l’Europe toute proche, reste toujours une ville-charnière entre les continents. On murmure depuis quelques années que la construction d’un tunnel sous le détroit, voire d’un pont serait en projet. Les réseaux autoroutier et ferroviaire espagnols qui parviennent au port d’Algésiras font face à celui qui se concrétise de l’autre côté du détroit. La ville reconquiert encore une fois, au début de ce XXIe siècle, sa position stratégique à la croisée des continents, et sa place symbolique dans l’espace national et international…
Mohamed Métalsi