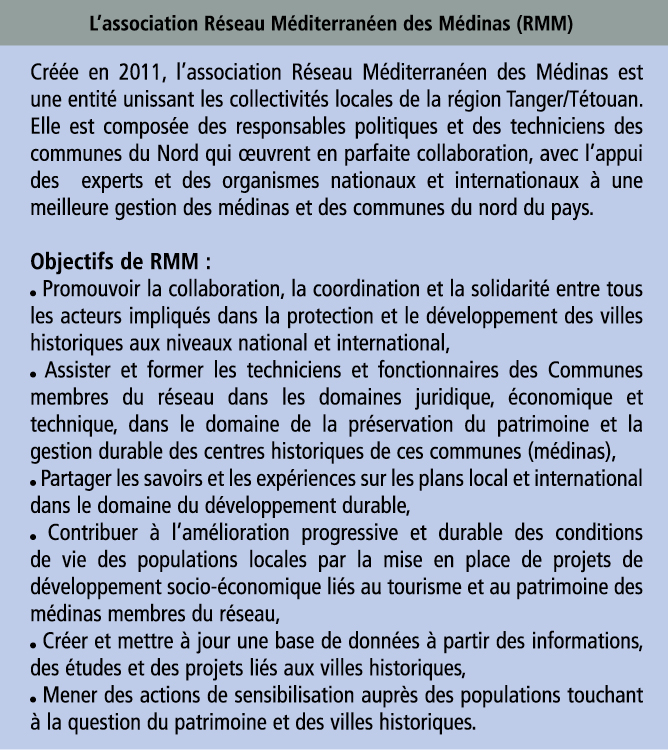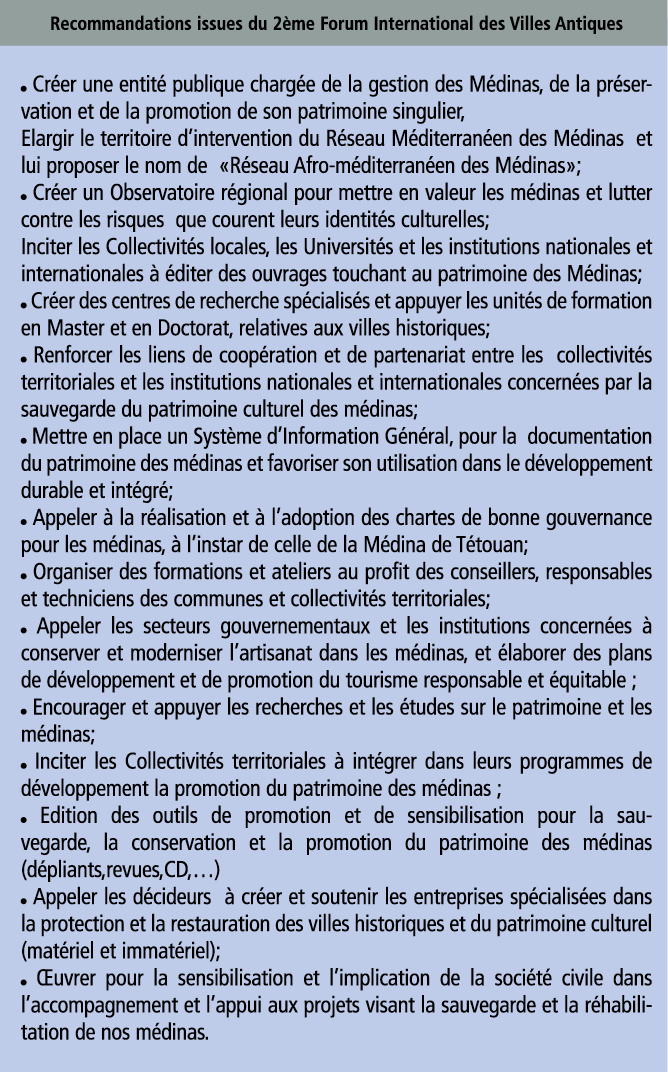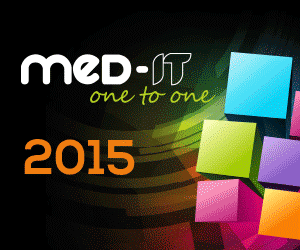2ème Forum international des villes antiques
Pour une revitalisation des liens historiques entre les deux rives de la Méditerranée
Tétouan a abrité du 14 au 16 mars 2013, la 2ème édition du Forum international des Villes Antiques. Organisé par l’association Réseau Méditerranéen des Médinas (RMM), sous la houlette des instances régionales et des collectivités locales de la région Tanger-Tétouan, il a réuni des experts nationaux et internationaux en provenance du Gabon, d’Espagne, de Tunisie, des Etats-Unis, d’Italie, de Suisse, de Palestine et de Jordanie. Cette deuxième édition s’est révélée riche en enseignements et a mis en lumière l’importance d’un renforcement des liens historiques et fondamentaux, qui unissent depuis toujours les deux rives de la Méditerranée.
Dans un contexte de globalisation et de perte de plus en plus marquée des repères identitaires, la question des héritages culturels et leurs enjeux est plus que jamais au cœur des débats mondiaux sur la préservation du patrimoine. Ces derniers font la promotion d’une approche durable qui s’appuie sur la mise en valeur des spécificités locales. En effet, des études récentes tendent à démontrer le rôle majeur des facteurs culturels et patrimoniaux dans la mise en place d’un processus de développement local durable. Le Maroc ne fait pas exception à cette règle. La Stratégie Nationale pour la réhabilitation des tissus urbains lancée il y a déjà quelques années, de même que le programme national de régionalisation ont conjointement révélé la nécessité d’impliquer les communes et les collectivités locales dans le processus de réhabilitation, de sauvegarde et de mise en valeur de leur patrimoine architectural. A ce titre, le Maroc dispose d’un patrimoine précieux composé de plus de 30 médinas plusieurs fois centenaires, qu’il devient urgent de protéger d’une dégradation continuelle, qui affecte aussi bien leurs fondations que leur cadre général. C’est pour tenter d’apporter des éléments de réponse à cette question que l’association Réseau Méditerranéen des Médinas (RMM) a vu le jour en 2011. Composée de responsables politiques et de techniciens des communes du Nord, RMM œuvre, en étroite collaboration avec des experts et des organismes locaux et internationaux, à une meilleure gestion des médinas et des communes du nord du pays. L’objectif étant d’assurer la capitalisation des expériences et la mutualisation des acquis des partenaires de l’ensemble du réseau méditerranéen. Grâce à l’optimisation des ressources financières, logistiques et humaines, le succès de l’initiative a été quasi immédiat. C’est ainsi qu’est né en 2012, l’évènement du Forum International des Villes Antiques. Ce dernier a été pensé comme une plateforme d’échange d’expertises et de pratiques diverses, unissant les villes membres du réseau. La première édition organisée à Chefchaouen a été l’occasion de mettre en place les fondements des liens entre les partenaires et de dégager des pistes de réflexion pour mieux cerner les possibilités d’échange entre les différents acteurs du Forum. Cette année, le choix des organisateurs s’est porté sur la ville de Tétouan. Des approches novatrices et des expériences nouvelles en matière de réhabilitation, de sauvegarde et de valorisation des villes antiques ont été exposées à une assistance variée, venue des quatre coins du pays. Composée essentiellement de chercheurs, de journalistes des deux rives, d’acteurs associatifs et d’étudiants, elle a également réuni de nombreux experts et spécialistes du patrimoine.

Panel consacré au rôle de la société civile dans la sauvegarde et la conservation des villes historiques. Au centre, M le Ministre Mohamed Benaissa, Président du Forum d’Asilah et modérateur du Panel.
Le premier axe de débat a touché au rôle des instances élues dans la sauvegarde et la mise en valeur des villes historiques. Plusieurs expériences dont celles des villes de Barcelone, de Tunis et de Malaga ont mis en exergue l’importance d’une implication des élus et des autorités locales dans toute démarche patrimoniale. A ce titre, l’expérience de la sauvegarde de la médina de Tunis et son impact sur le développement global de la ville s’est révélée édifiante. Lors de son exposé intitulé : « La réhabilitation de la médina comme vecteur de développement», Mme Faïka Béjaoui, directrice adjointe, chargée de la réhabilitation et du permis de bâtir à la Mairie de Tunis a révélé plusieurs points forts du projet de restructuration de la médina de Hafsia. Parmi ceux-là, on notera l’assistance technique offerte à l’habitant de la médina dont la demeure nécessite une restauration. La municipalité de Tunis se charge dans un tel cas de la sélection des corps de métier, de leur encadrement et du suivi des travaux. Outre son efficacité, une telle démarche permet de s’assurer d’une bonne qualité d’exécution des travaux et de leur adéquation totale avec les cahiers de charges préétablis. Un remboursement des frais liés à ces travaux est ensuite exigé des propriétaires, voire des locataires, selon des modalités précises. Autre point important de l’expérience tunisoise est l’implication des habitants de la médina dans le processus de sauvegarde et de valorisation du patrimoine qu’elle constitue. A ce sujet, des actions de sensibilisation ont été menées auprès de ses habitants, grâce notamment à un programme de chantiers-écoles. Celui-ci consiste à former des jeunes aux diverses techniques de restauration et aux enjeux de la préservation du patrimoine matériel. Plusieurs chantiers ont ainsi vu le jour à la médina de Tunis et ont permis la restauration de bâtiments, de places ou de placettes. Ces actions programmées ont constitué autant d’opportunités d’emploi pour une population connue pour sa précarité. S’en est ensuivi un réel essor de l’ancienne médina de Tunis. En l’espace de quelques années, celle-ci s’est muée en véritable pôle économique et attractif, attirant aussi bien les investisseurs que les touristes locaux et étrangers. La requalification des centres historiques de l’ensemble des villes méditerranéennes présentées dans ce panel, tend d’ailleurs à démontrer que celle-ci a un impact direct sur le tourisme, spécialement le tourisme culturel, et par là même sur la qualité de vie globale des populations.
Le deuxième axe de débat a concerné le rôle de l’Etat et des institutions internationales dans la protection, la sauvegarde et la valorisation des villes anciennes. Un bref retour historique sur la stratégie du Maroc en matière de sauvegarde des médinas débutée dès 1977, a été présenté en introduction par l’architecte Abderrahim Chorfi. Selon lui, une prise de conscience relativement précoce du gouvernement marocain des enjeux du patrimoine, conjuguée à une architecture spécifique dont les murailles et les enceintes, ont certainement contribué à une meilleure conservation de nos médinas historiques. Ces dernières étant d’ailleurs demeurées, pour la plupart, des centres urbains vivants et dynamiques. Les organismes internationaux tels que l’Unesco et l’Icomos ont également joué un rôle de premier plan dans l’accompagnement et la sensibilisation à la valeur ajoutée que représente notre patrimoine architectural. La convention du patrimoine de l’Unesco et les chartes de l’Icomos pour la préservation des centres historiques ont notamment servi de plateforme pour véhiculer des concepts relatifs à la protection des tissus anciens et à leur mise en valeur. Parmi les urgences nationales évoquées par Chorfi se trouve la nécessité de déterminer des objectifs précis, pondérables et échelonnés dans le temps. Des questions touchant au nécessaire retour des classes dites « moyennes » au sein de nos médinas et le problème récurrent du foncier ont également été pointés du doigt par l’architecte.
De son côté, M Fernando Fernandez Gomez, membre du Centre Unesco de Séville (Espagne) a mis en exergue la nécessité de donner une utilité sociale aux bâtiments pour mieux en assurer la pérennité. Selon lui, une architecture dite « préventive » devrait être adoptée dans les centres historiques. Les opérations de réhabilitation devraient être réversibles et permettre en tout temps de retrouver le bâtiment initial. Des rapports détaillés doivent également accompagner toute opération de réhabilitation.
Un autre volet important du second panel a touché aux plans de gestion des villes historiques. A ce titre, le cas de la ville de Rabat, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco a fait figure de proue. En effet, la capitale administrative et culturelle du Royaume a fait preuve d’une démarche exemplaire en présentant son plan de gestion modèle, conjointement au dossier de demande d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est probablement cette approche globale, qui est à l’origine du succès de son initiative qui ne manquerait certainement pas de faire des émules, l’expérience ayant montré qu’au Maroc de nombreux ratages étaient dus à une mauvaise gestion du site après l’inscription.
Dans son exposé, Khalid Harchi de l’Agence de développement de la région du Nord (APDN) a mis l’accent sur le rôle de l’Agence dans la sauvegarde et la réhabilitation des villes historiques. Il a insisté sur l’urgence d’une viabilisation de nos médinas notamment par un système d’assainissement et de gestion des déchets approprié, afin de stopper leur dégradation continue. Créée en 1995 et disposant d’une autonomie financière, l’APDN joue un rôle incontournable dans la mise en valeur des médinas du nord. Celles-ci ne sont pas considérées comme des îlots et doivent faire l’objet d’une réelle prise en charge, intégrée dans le développement global de la région.

L’architecte Hanae Bekkari, vice-présidente de l’Association Tanger Médina, lors de son intervention.
Présentée par Fernando Lopez Gil, délégué du Gouvernement andalous à Cadiz (Espagne), l’expérience andalouse s’est également avérée riche en enseignements sur les dispositifs mis en place par les communes andalouses pour contribuer à une meilleure conservation de la ville antique, dont on retient essentiellement :
– La codification du patrimoine et sa protection par une assise juridique,
– La ratification d’une loi sur la protection du patrimoine historique de l’Andalousie,
– La nomination de la Junta de Andalucia comme unique gestionnaire du patrimoine,
– La mise en place de programmes pédagogiques spécifiques, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale pour sensibiliser la jeune population à l’importance du patrimoine.
La coopération internationale et son apport en terme d’expertise ont également été abordés lors du troisième panel. A ce sujet, l’expérience des échanges Maroc/Espagne a constitué un volet important des présentations dont on retient essentiellement le programme d’Ecole-Atelier lancé avec l’AE-CID, il y a quelques années et dont les résultats ont été préalablement éprouvés par nos voisins andalous. L’association Rif Al Andalous sise à Chefchaouen a offert un bel exemple d’application du système de chantiers-écoles au sein de la médina de cette authentique ville du nord, nichée aux pieds des montagnes, néanmoins enclavée et offrant peu de possibilités d’insertion professionnelle à ses jeunes. Grâce à ce programme ambitieux, de nombreux édifices de la médina ont pu être restaurés dans les règles de l’art. Ce qui a redonné à celle-ci son lustre d’antan.

Le Forum International des Villes Antiques a été l’occasion pour l’organisation de signer de nombreuses conventions de partenariats avec des communes et des villes partenaires.
L’avant-dernier panel a été consacré à un important volet touchant à la société civile et à son rôle dans la préservation du patrimoine. L’expérience de l’architecte Hanae Bekkari, vice-présidente de l’Association Tanger Médina et responsable du projet de réhabilitation de la forteresse Bab Al Marsa à Tanger a mis le doigt sur le rôle des acteurs associatifs dans le processus de revitalisation du patrimoine. La restauration de cette forteresse antique et sa reconversion en espace socio-culturel ouvert aux artistes de la médina ont donné un bel exemple d’un projet réussi, ouvert sur son environnement qui pérennise le patrimoine. Bab Al Marsa a ainsi mis en lumière diverses facettes d’une opération de réhabilitation réussie, qui s’inscrit favorablement dans l’environnement qui l’accueille.
Enfin un dernier panel a été consacré à la collaboration du secteur universitaire à la formation et à la sensibilisation aux techniques de la restauration du patrimoine. Les experts en provenance d’établissements nationaux et internationaux invités ont fait part de leurs projets au sein de leurs établissements respectifs. La plupart accueillent des modules, voire des cursus longs dans le domaine de la réhabilitation et de la restauration. Parmi eux, l’Académie des Beaux-arts Aldo Galli, à Milan, qui propose un Master en restauration du patrimoine, de plus en plus prisé en Italie, comme à l’international. Dans le domaine de l’édition, des ouvrages importants consacrés à l’histoire de nos médinas, dont celle de Tétouan ont vu le jour grâce à la collaboration du secteur universitaire. La qualité des recherches qu’ils présentent et la finesse de leurs analyses sont un atout important pour l’éveil des consciences et la sensibilisation aux dangers et risques encourus par nos médinas. Le Forum a également connu une forte participation des étudiants du Master en tourisme de l’Université Abdelmalek Essaâdi, à Tétouan. Grâce à une formation adaptée, ces derniers ont été en mesure de s’impliquer tant au niveau organisationnel qu’a celui de l’accueil et de l’encadrement, spécialement des visites de sites. Le Forum international des Villes antiques a ainsi démontré son pouvoir fédérateur et sa capacité à mobiliser la population étudiante tout en la sensibilisant à son projet. A ce sujet, il est à noter que le Réseau Méditerranéen des Médinas a signé diverses conventions de partenariat avec des universités étrangères, dont celles de Cadiz et de Granada (Espagne), l’Université du Yarmouk (Jordanie), l’Université de Floride (USA), l’Université de Tlemcen (Algérie), et l’Académie Galli de Milan (Italie). Des accords ont également été signés avec les organismes suivants :
-Le Ministère de la Culture,
-La Ville de Oyem (Gabon),
-Les organismes, villes et gouvernements locaux de l’Union africaine,
-Les communes et les municipalités de: Tétouan, Chefchaouen, Asilah, Ksar El Kébir, Larache, Ouazzane, Oued Laou, Kasr El Majaz,
-L’Agence de promotion et de développement économique et social des provinces et préfectures du nord (APDN),
-L’Université Abdel Malek Essaâdi (Tétouan).
A l’issue de ce deuxième Forum des villes antiques, une série de recommandations a été adoptée qui constitue une feuille de route pour l’ensemble des acteurs présents, en vue de renforcer l’action solidaire localement, comme à l’international. Cette édition a offert l’opportunité à nos partenaires méditerranéens de constater l’importance de l’action collective pour une meilleure capitalisation des acquis en matière de gestion et de valorisation du patrimoine. Grâce à un passé historique et à une mémoire commune, la Méditerranée constitue un réservoir inépuisable d’expériences, de pratiques et de savoir-faire qui constituent autant de références valables pour nos médinas. Les expériences positives menées par des villes partenaires, en matière d’implication de l’Etat et des conseils élus ont révélé toute l’importance d’une démarche collégiale dans ce domaine. La protection et la gestion novatrice du patrimoine culturel étant des conditions sine qua non de la promotion du tourisme culturel sur l’ensemble du pourtour méditerranéen, on ne peut que saluer les initiateurs de ce Forum régional, qui ne manquera pas, on l’espère, d’inspirer des actions concrètes sur l’ensemble de nos communes urbaines.
Nadia Chabâa